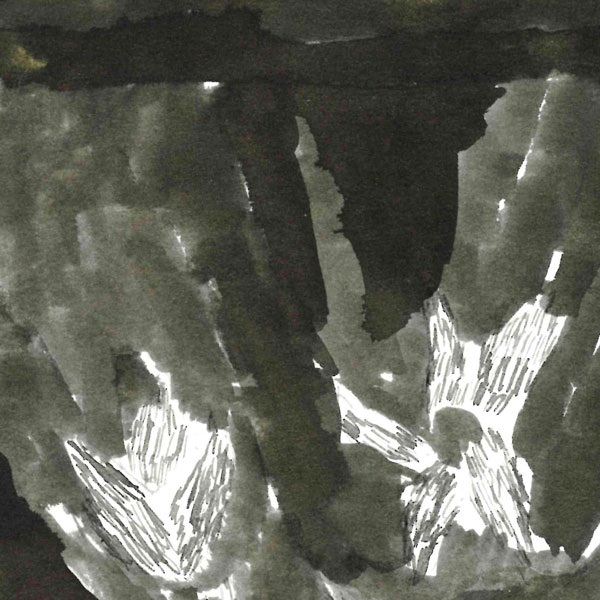Avoir bon d’avoir peur
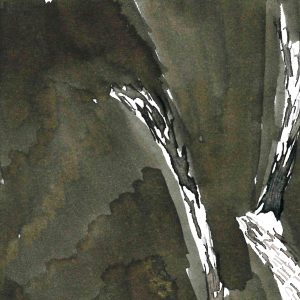
Auteur : Catherine Thieron, animatrice au Centre Franco Basaglia
Résumé : La peur a mauvaise presse, mais il semblerait qu’à petites doses, et lorsqu’elle est choisie plutôt que subie, elle pourrait avoir un impact positif sur notre psyché. Les films d’horreur et le saut à l’élastique seraient-ils bons pour notre santé mentale ?
Temps de lecture : 15 minutes
Nous étions en hiver, les nuits étaient longues, et comme chaque hiver aux nuits trop longues, je tricotais en pyjama en pilou devant les documentaires criminels chers à mon cœur, le chat assoupi à mes côtés (à chacun sa vision du bonheur).
Je me suis alors demandée pourquoi – et contre toute attente – ces contenus passablement anxiogènes avaient un effet étrangement apaisant sur la grande anxieuse que je suis…
Rendez-vous avec la peur
« La longue histoire du cinéma d’horreur prouve que les gens aiment avoir peur pour se divertir, constate l’auteure scientifique Nina Nesseth, [et] une bonne partie des gens qui clament détester les films d’horreur ont plus probablement une aversion contre un style ou un type d’horreur en particulier. (…) C’est un genre aussi vaste que les peurs humaines, et il revêt tout autant de formes ».[1]
Ainsi existe-t-il sans doute autant de définitions de l’horreur et de l’épouvante que de spectateurs et spectatrices, et même partagée au sein d’une salle obscure, l’expérience de la peur est tout à fait personnelle. Mais qu’est-ce qui peut bien nous pousser à nous exposer joyeusement à des histoires sinistres et sordides que le bon sens, en toute logique, voudrait que nous évitions ?
Une étude de 2020 a mis en évidence que, « [b]ien que la plupart des gens regardent un film d’horreur avec l’intention de se divertir plutôt que d’apprendre quelque chose, les histoires effrayantes offrent de nombreuses opportunités d’apprentissage. La fiction permet au public d’explorer une version imaginaire du monde à très peu de frais. Grâce à la fiction, les gens peuvent apprendre à échapper à de dangereux prédateurs, à naviguer dans de nouvelles situations sociales (…) ». Les auteurs de cette étude émettent ainsi l’hypothèse que « [l]’une des raisons pour lesquelles l’utilisation de l’horreur peut être corrélée à moins de détresse psychologique est que la fiction horrifique permet à son public de s’entraîner à lutter contre les émotions négatives dans un cadre sécurisé. En craignant le meurtrier ou le monstre à l’écran, le public a la possibilité de pratiquer la régulation des émotions. Vivre des émotions négatives dans un cadre sûr, comme devant un film d’horreur, peut aider les individus à affiner leurs stratégies pour y faire face et à gérer plus calmement les situations qui suscitent la peur dans la vie réelle. »[2]
Ces histoires nous permettraient donc d’apprivoiser en toute sécurité des stimuli émotionnels tels que la peur, l’angoisse ou le dégoût, communément considérés comme négatifs.
À l’intérieur
Demandez à n’importe quelle personne ayant regardé un film d’horreur à mes côtés, elle vous dira que c’est une expérience extrême en soi : dans un silence religieux, ma seule présence offre à mes voisines et voisins de siège ce qu’il convient d’appeler la 3D interactive, puisque je gigote, gesticule et sursaute beaucoup.
Physiquement, voilà ce qui se passe : le jump scare[3] est un réflexe de sursaut que nous partageons avec de nombreuses autres espèces animales. Le système nerveux sympathique réagit alors de façon quasi-instantanée pour libérer du cortisol, de l’adrénaline et de la noradrénaline dans le corps, augmentant la tension artérielle. Ce réflexe est responsable de la fameuse réaction de combat ou de fuite censée nous protéger face à un danger. Lorsque la menace est passée, que nous sommes vivants et indemnes, la dopamine prend le relais pour nous faire ressentir du soulagement et, dans le meilleur des cas, du plaisir, voire de l’euphorie.
Selon le chercheur Mathias Clasen, spécialisé dans l’étude de ce qu’il appelle la « peur récréative »[4], cette réaction est « cognitivement impénétrable. Vous ne pouvez pas l’éteindre et vous ne pouvez pas faire grand-chose pour atténuer la réponse même si vous savez qu’un sursaut arrive ». D’ailleurs, les cinéastes ne s’y trompent pas puisqu’ils savent désormais que « les amateurs de films d’horreur sont capables de prédire les jump scares, alors les réalisateurs font tout pour tromper leur public en manipulant la formule. »[5]
Je n’ai donc pas fini de sursauter, de préférence dans le confort et la sécurité d’un siège moelleux, mais il existe bien d’autres manières de se faire peur…
Funny games
Déjà dans les années 1950, cette tête brûlée d’Ernest Hemingway aurait cité la tauromachie, la course automobile et l’alpinisme comme étant les trois seuls sports valables à ses yeux ; les années ’70 virent naître le bien nommé Dangerous Sports Club en Angleterre, qui développa le saut à l’élastique tel que nous le connaissons, et la télévision se chargea de populariser les sports dits « extrêmes » dès la fin des années ’90. Aujourd’hui, certaines disciplines considérées jadis comme témoignant d’une pulsion de mort accrue de la part de ses participants sont accueillies aux Jeux Olympiques, comme le surf, l’escalade, le skateboard, ou encore le kitesurf qui fera son apparition aux J.O. de Paris en 2024.
Comme quoi, les pratiques et les perceptions changent, et comme celles-ci, la recherche entourant les « sports extrêmes » – un terme aussi récent que fourre-tout – a considérablement évolué depuis les années ’60 : à l’époque, la science prêtait volontiers aux athlètes de l’extrême des valeurs déviantes découlant d’un désir de se rebeller contre la société dominante ou d’afficher des caractéristiques perçues comme viriles ; dans la recherche contemporaine, l’impact des sports extrêmes sur la santé mentale et le bien-être est désormais un thème récurrent, étudié, rapporté et soutenu.[6]
F. pratique le parachutisme en amateur depuis près d’une décennie. « Dans beaucoup de sports extrêmes, m’explique-t-il, la peur est utilisée comme un moteur pour se dépasser, progresser ou simplement se sentir “vivre”. J’ai effectué près de mille sauts, et encore maintenant, j’ai des périodes de stress ou de peur dans l’avion. Ces épisodes d’appréhension me permettent de me concentrer et de profondément me focaliser sur mon saut. J’associe cet état d’esprit à de la méditation, que je pratique aussi.
Durant le saut, le temps s’arrête, et tous les petits tracas de la vie n’existent littéralement plus pendant ce moment court (environs 45 secondes de chute libre) et pourtant infini. Ce même constat de temps qui s’arrête se retrouve dans beaucoup de disciplines de sauts, et c’est avant d’effectuer des sauts de falaise que j’ai ressenti mes plus grosses peurs et tous les bénéfices qui en résultent, à commencer par un sentiment de plénitude.
Je pense que chaque sport extrême nécessite de la peur de ses pratiquants, et on dit souvent dans le parachutisme qu’un pratiquant qui n’a plus peur devient un danger pour lui et pour les autres. »
Cette confrontation volontaire à la peur lui donne le sentiment d’avoir une meilleure appréhension du danger et de la maitrise de lui-même face à une situation risquée, même s’il avoue volontiers être rarement confronté à ce type de situations au quotidien.
Les sports extrêmes seraient-ils la version adulte de « jouer à se faire peur » ?
Car la confrontation avec nos frayeurs commence dès le plus jeune âge…
Jeu d’enfant
« À l’origine, explique l’historienne du conte Elisabeth Lemirre, le conte est destiné à une communauté [qui] se réunit dans des cérémonies ritualisées, des veillées après des travaux, des cérémonies de fêtes, par exemple après un mariage, et le conteur conte. Toute la communauté est réunie autour de lui : aînés, adultes, enfants. À l’origine, il n’y a donc aucune différence entre contes pour enfants et contes pour adultes. »[7] Ce n’est qu’au XIXe siècle que le conte commence à cibler tout particulièrement les enfants à des fins éducatives… en leur faisant peur – avec une mention toute spéciale aux frères Grimm et à Hans Christian Andersen, dont les contes ont marqué (pour ne pas dire traumatisé) des générations entières de bambins.
Pour le pédopsychiatre Patrick Ben Soussan, ce face-à-face avec la peur est « une façon de confronter les enfants à ce qui fait les émotions du monde, en particulier les “grandes” comme la surprise, la colère, la peur, la joie… Il y a des histoires qui vont contenir cet ensemble de propositions » qui aident à la compréhension des ressentis. « Ces histoires, poursuit-il, permettent à l’enfant d’éprouver et de rencontrer ces émotions-là dans un melting pot de scénarios et de situations le plus large possible. En effet, plus il en connaît, plus ce sera riche pour lui et favorisera son développement émotionnel plus tard. La reconnaissance des émotions d’abord, et ensuite l’adaptation dont l’enfant va faire preuve face à ces émotions : rester en retrait, ou au contraire aller de l’avant, être dans la retenue ou participer avec joie et allégresse. L’enjeu, ce n’est pas tant la “gestion” des émotions que la capacité de l’enfant à les comprendre, comme s’il s’agissait du vocabulaire d’une langue étrangère. »[8]
Une peur bien encadrée peut donc être bénéfique même aux plus petits, pour peu, bien entendu, que le contenu soit adapté. Pour ce faire, rien de mieux que les conseils avisés de libraires ou de cinéphiles. Si un doute subsiste, le site Common Sense Media[9] peut s’avérer particulièrement utile puisqu’il recense des avis de parents et d’enfants, pour examiner des médias (films, séries, livres, jeux vidéo, etc.) et évaluer leur pertinence pour le jeune public.
Les autres
Nous l’avons vu : il peut être bon de (jouer à) se faire peur, mais est-ce que cette exposition volontaire change quoi que ce soit à nos appréhensions, notamment face à ce que l’on appelle communément « la folie » ? Après tout, le fou dangereux hante le cinéma d’horreur et d’épouvante depuis des décennies, et le trouble psychique y est souvent synonyme de criminalité et de folie furieuse[10].
Pour une personne peu sensible aux questions de santé mentale, la consommation de loisirs « effrayants » ne dépasse sans doute pas le simple divertissement ; pour une personne aux prises avec le trouble psychique, ils peuvent être une évasion où la peur s’amenuise parce qu’elle est sous contrôle. La peur « récréative » peut donc être d’une grande utilité si elle permet à une personne d’affronter et ainsi de relativiser ses propres angoisses.
De manière générale, l’art peut aider à faire face à la douleur, et l’observation de monstres et de fantômes peut avoir un effet cathartique dans une existence en souffrance : les sursauts et la chair de poule ont le pouvoir d’apporter un coup de fouet et une vitalité toute neuve, et les histoires (de fantômes ou autres) permettent de générer de l’empathie.
Bien que passagères, ces émotions contribuent au sentiment d’être profondément, intensément vivant… et la peur n’est qu’une façon parmi d’autres d’y accéder.
Si vous n’aimez pas vous faire peur, n’ayez crainte : l’apocalypse zombie n’aura pas lieu !
[1] Nina Nesseth, « Nightmare Fuel: The Science of Horror Films », Tor Nightfire, 2022.
[2] Coltan Scrivner, John A. Johnson, Jens Kjeldgaard-Christiansen, Mathias Clasen, « Pandemic practice: Horror fans and morbidly curious individuals are more psychologically resilient during the COVID-19 pandemic », Personality and Individual Differences, volume 168, 1er janvier 2021, 110397.
[3] Le jump scare (littéralement « saut de peur ») a été défini par le réalisateur John Carpenter – qui sait comment faire sursauter son public – comme « A quick move and a loud sound (Un geste rapide et un bruit fort). »
[4] Il est le fondateur du Recreational Fear Lab, une unité de recherche de l’Université de Aarhus (Danemark) dédiée à l’étude des loisirs suscitant de la peur. https://cc.au.dk/en/recreational-fear-lab/
[5] Mathias Clasen, « A Very Nervous Person’s Guide to Horror Movies », Oxford University Press, 2021.
[6] E. Brymer, F. Feletti, E. Monasterio, R. Schweitzer, « Editorial: Understanding Extreme Sports: A Psychological Perspective ». Front. Psychol. (2020)
[7] Pourquoi raconte-t-on des histoires qui font peur aux enfants ?, France Culture, 14 juillet 2022
[8] Ibid.
[9] https://www.commonsensemedia.org/ (site en anglais et en espagnol)
[10] Voir à ce sujet notre analyse « Folie furieuse : la fin d’un mythe ? », 1er juillet 2022.