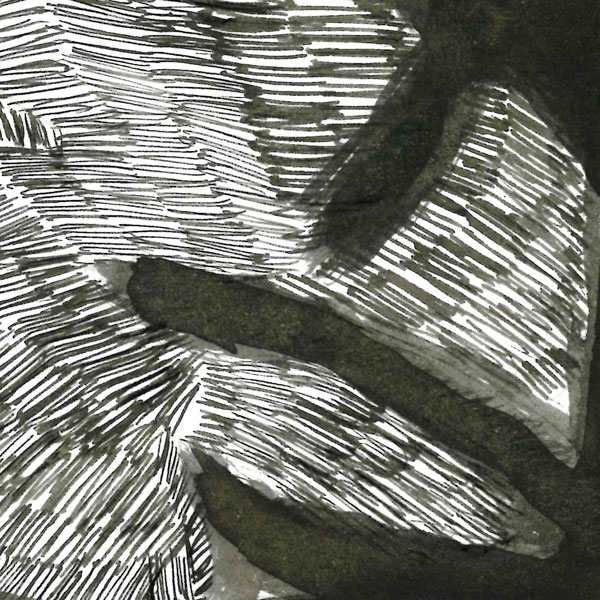Folie furieuse : la fin d’un mythe ?

Auteur : Catherine Thieron, animatrice au Centre Franco Basaglia
Résumé : Encore largement associée à la dangerosité dans l’inconscient collectif, ce que l’on appelle « la folie » fascine autant qu’elle effraye et fournit – à tort ou à raison – une source d’inspiration inépuisable pour les créateurs de tout poil. Mais d’où provient cette image du fou furieux, et surtout : est-elle fondée ?
Temps de lecture : 15 minutes
Autrefois enfermés avec les criminels et les indigents, les fous furent exorcisés au Moyen-Âge – et jetés au bûcher si l’exorcisme venait à échouer – avant d’être rassemblés au sein d’asiles spécialement conçus pour eux dès la fin du XVIIIe siècle. Une manière comme une autre de couvrir cette folie que l’on ne saurait voir…
Puisqu’elle nous est cachée, elle suscite du fantasme ; puisque nous la croyons enfermée, elle suscite de la peur… « La peur est la plus vieille et la plus forte émotion de l’humanité, et le plus vieil et plus fort type de peur demeure la peur de l’inconnu », disait l’auteur H.P. Lovecraft, dont les protagonistes finissaient toujours par perdre la raison, d’une manière ou d’une autre. Cette peur de l’inconnu, supposée nous préserver du danger, repose ici sur une profonde méconnaissance de l’autre et de son état : le trouble psychique fait peur parce que les images qui nous en sont renvoyées sont bien souvent spectaculaires ou effrayantes ; l’austère et cruel asile victorien continue de faire écho dans l’inconscient collectif, et le personnage du fou dangereux hante inlassablement le paysage médiatique. La réalité, pourtant, est très différente…
Le fantasme de la dangerosité
Une étude de 2005 a établi que par rapport aux années 1950, le public est 2,3 fois plus susceptible de décrire une personne atteinte d’un trouble psychique grave comme potentiellement dangereuse, en raison de la manière dont les médias de masse traitent le sujet.[1] En effet, il y a quelques décennies, le tueur psychotique ou « criminellement fou » était relativement rare et apportait une diversité bienvenue au sein d’une galerie de portraits alors principalement habitée par de méchantes créatures non-humaines – vampires, extra-terrestres, momies, loups garous, etc.
La schizophrénie semble tout particulièrement nourrir les fantasmes, car souvent confondue avec le trouble dissociatif de l’identité (autrefois appelé trouble de la personnalité multiple), tel qu’on a pu le lire ou le voir dans (spoilers !) Psychose d’Alfred Hitchcock (1960), Fight Club de Chuck Palahniuk (1996), porté à l’écran par David Fincher en 1999, ou encore Split de Night M. Shyamalan (2016). Ce dernier piochait déjà allègrement dans ces clichés pour son précédent film, The Visit (2015), en dressant le portrait d’un couple de dangereux psychopathes fraîchement évadés de l’hôpital psychiatrique tout proche…
S’ils avaient pris la peine de se renseigner, les créateurs de ces œuvres auraient pourtant réalisé que le trouble psychique ne rend pas intrinsèquement dangereux, et qu’il est peu probable que des personnages comme ceux mis en scène soient en mesure d’échafauder de tels plans – et certainement pas sur la durée…
Soyons réalistes un instant, voulez-vous : n’importe quel individu lambda serait déjà bien en mal de porter de tels projets à bout de bras ; que penser alors de quelqu’un dont la maladie altère la cognition ?
Sans remettre en question les qualités littéraires ou cinématographiques de ces œuvres, le prétexte de la pathologie pour expliquer un passage à l’acte criminel n’est bien souvent qu’une solution de facilité, une pirouette narrative aussi pratique que, n’ayons pas peur des mots, paresseuse. Cette image est particulièrement dommageable pour les personnes touchées, car elles sont en réalité plus susceptibles d’être les victimes que les auteurs de violences.[2] En effet, « [l]e pourcentage d’actes de violence attribuable aux malades mentaux est estimé entre 3 à 5%, ce qui signifie que si on arrivait à éradiquer la violence liée aux troubles psychiatriques, 95 à 97 % des actes de violence continueraient d’être perpétrés »[3] et « [l]e risque de passage à l’acte violent serait sensiblement identique dans la population présentant un trouble psychique et dans la population générale (…) Par ailleurs, les personnes présentant des troubles psychotiques chroniques sont davantage exposées à la précarisation (ce qui constitue un risque supplémentaire d’addiction) et à la marginalisation. Il faut savoir également que la précarisation multiplie par 10 le risque de passage à l’acte violent.
Il est essentiel de rappeler que l’abus de substances psychoactives ou les antécédents de violence constituent des facteurs prépondérants de passage à l’acte criminel, que la personne soit ou non atteinte de pathologie mentale. Ces notions de facteurs de risque sont d’une importance capitale et pourtant elles sont trop rarement mises en exergue. »[4].
Bien que le trouble psychique ne mette évidemment pas à l’abri d’éventuels accès de violence, la représentation quasi-systématique du fou furieux rend le travail plus difficile pour tout le monde, à commencer par les personnes concernées, bien sûr, mais aussi pour leur entourage et le personnel soignant, comme l’explique le psychiatre Jean-Victor Blanc : « Quand on doit annoncer à un patient un diagnostic de schizophrénie, il va davantage penser à la représentation souvent violente et fantasmée des films qu’il a vus qu’à la réalité des livres de médecine : il va se reconnaître dans tout ce qu’il a entendu, lu, vu sur la schizophrénie. Des études cliniques prouvent que pour les Français, on retrouve deux stéréotypes lors des troubles psychiques à savoir la schizophrénie — et dans ce cas c’est le fou dangereux — ou bien le dépressif, et là ressort davantage une notion de faiblesse, de fatigue, voire de fainéantise. C’est la représentation des grandes enquêtes, qu’on retrouve donc logiquement dans les films. Et tant que les gens n’en sauront pas plus sur la santé mentale, c’est difficile pour eux de distinguer la réalité des fantasmes du scénariste ! »[5]
Werther et Papageno
Si la schizophrénie continue de nourrir tous les fantasmes, les troubles anxieux, la dépression ou encore le trouble bipolaire commencent, eux, à être traités avec davantage d’empathie, au risque parfois de tomber dans l’excès inverse, à savoir la tentation de romancer des maladies pourtant sérieuses, potentiellement handicapantes, et parfois létales. « Nous avons créé tellement de personnages dépressifs qui se trouvent également être magnifiques, talentueux, épanouis dans leur réussite (tout ce que nous voulons pour nous-mêmes), constate Katlyn Firkus, que nous commençons à les imiter. Nous avons créé tellement de personnages de ce type que nous avons commencé à croire qu’un passé sombre, la souffrance, la dépression sont des précurseurs nécessaires à l’éclat. »[6]
Quand Johann Wolfgang von Goethe sort Les souffrances du jeune Werther en 1774, son roman épistolaire rencontre un immense succès. L’histoire d’amour impossible entre Werther et Charlotte, promise à un autre et fidèle à son fiancé, se solde par le suicide du jeune homme. Le roman aurait entrainé à l’époque une vague de suicides par mimétisme à travers l’Europe. Bien que le lien de cause à effet n’ait jamais été formellement démontré[7], le sociologue états-unien David Phillips donne au phénomène le nom d’effet Werther deux siècles après la publication du roman.
Contemporain du jeune Werther, l’oiseau Papageno apparait quant à lui dans l’opéra La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart. Croyant avoir perdu son amoureuse, il envisage de mettre fin à ses jours jusqu’à ce que d’autres personnages l’aident à résoudre ses problèmes. L’effet portant son nom désigne aujourd’hui les pratiques, notamment médiatiques, pouvant influencer de manière positive les personnes ayant des pensées suicidaires, en mettant l’accent sur des alternatives, selon les recommandations de l’OMS : « le traitement médiatique du suicide, lorsqu’il est conforme à certaines directives, révèle un fort potentiel de prévention et n’entraîne pas de nouveaux cas de suicides. »[8] Ces directives comprennent entre autres l’indication de numéros d’aide ou encore l’inclusion dans l’article ou la séquence télévisée de témoignages de personnes étant parvenues à faire face à leurs idées suicidaires…
Hélas, « les histoires d’espoir et de résilience reçoivent bien moins de couverture médiatique que les histoires de mort par suicide », déplore le chercheur Thomas Niederkrotenthaler, co-auteur d’une étude sur l’effet Papageno[9].
Mensonges par omission
La responsabilité médiatique est tout aussi importante, sinon plus, dans le traitement des crimes perpétrés par des « forcenés », comme aime à les appeler la presse, et bien des actes, quand ils ne sont pas de manière évidente ceux d’un terroriste, seront naturellement attribués à un « déséquilibré ». Cela permet une mise à distance salutaire, une étiquette commode tenant la personne à l’écart de nos propres valeurs : si le criminel est fou, il ne peut pas être comme nous. Et s’il est déclaré « fou » au moment des faits par un tribunal, il ne peut pas être reconnu responsable de ses actes et n’ira donc pas en prison…
Ainsi se terminent certains épisodes de vos documentaires criminels préférés, qui omettent cependant un détail non négligeable : à défaut d’aller en prison, la personne sera internée dans ce que l’on appelle un établissement de défense sociale. « L’internement est une mesure de sûreté envisagée lorsqu’une personne atteinte d’un trouble mental grave commet un crime ou un délit menaçant l’intégrité physique et psychique de tiers. Encore appelée « mesure de défense sociale », son objectif n’est pas de punir, mais d’associer trois éléments qui s’avèrent difficilement conciliables en pratique : le soin, la réinsertion et la protection de la société. (…) Les personnes internées y gravitent, captives de cette inexorable expédition, loin des aires de vie de ceux qui sont sains d’esprit. Et parfois leur traversée dure longtemps. Très longtemps. »[10]
D’autant plus longtemps que là où une peine de prison est limitée dans le temps, l’internement est quant à lui une mesure à durée indéterminée…
L’omission par les médias d’éléments pourtant essentiels à la compréhension, tant du trouble psychique que du cadre légal, entrave toute possibilité d’empathie. Rendre intelligibles certains actes n’enlève certes rien à l’affect qu’ils suscitent, mais cela donne des clés pour se représenter de manière plus juste et plus complète les tenants et aboutissants. Cela permet aussi de remettre un peu d’humanité au cœur du propos et de se souvenir, peut-être, que nul n’est aussi mauvais que le pire de ses comportements…
Vers de nouvelles représentations
Selon le psychiatre Vasilis Pozios, « [i]l devient de moins en moins rare d’avoir des représentations réalistes du trouble psychique, mais une chose qui est encore extrêmement rare, ce sont les représentations de héros touchés (…) Il y a beaucoup de gens qui vivent, travaillent, élèvent des familles et souffrent de troubles psychiques comme le trouble bipolaire. C’est bien de rompre la stigmatisation en montrant que les personnes atteintes ne sont pas des parias ou violentes, mais cela brise également les clichés des représentations du trouble psychique dans le divertissement. »[11]
Ainsi la fiction met-elle en scène depuis plusieurs années des personnages complexes et multidimensionnels dont le trouble, bien que présent, ne les résume pas plus qu’il ne fait d’eux un danger : leur condition n’est en réalité – comme, bien souvent, dans la réalité – qu’une des nombreuses facettes de leur personnalité. Dans Silver Linings Playbook (Happiness Therapy) (2012), par exemple, le personnage interprété par Bradley Cooper sort d’une période d’hospitalisation pour soigner un trouble bipolaire, également représenté dans le film Infinitely Polar Bear (Daddy Cool) (2014) et la série Shameless (2011-2021). Le personnage principal de The Perks of Being a Wallflower (Le Monde de Charlie) (2012) se remet d’une dépression majeure suite à un traumatisme. Dans la série After Life (2019-2022), Ricky Gervais incarne un homme dévasté par la mort de sa femme et qui, dès la première scène de la première saison, s’apprête à mettre fin à ses jours. Les séries Atypical (2017-2021) et As We See It (2022) mettent en scène le quotidien de personnages autistes, tout comme la marionnette Julia, apparue dans l’émission pour enfants La Rue Sésame en 2017. Quant à la jeune héroïne du récent Metal Lords (2022), elle est aux prises avec un trouble jamais cité et sous traitement médicamenteux pour celui-ci…
Ces productions abordent le trouble avec empathie, donnent un visage humain – et non monstrueux – à la souffrance psychique, et apportent autant d’exemples déconstruisant les stéréotypes les plus répandus (et les plus datés). Non contentes de proposer au public une image plus nuancée de la vie avec la pathologie, elles peuvent aussi influencer de manière positive les personnes aux prises avec le trouble psychique : être confrontées à des représentations plus proches de leur vécu peut briser le sentiment de solitude qui va souvent de pair avec l’expérience de la maladie et aider à réaliser qu’il n’est pas impossible de vivre avec.
Enfin, ces nouvelles représentations peuvent faciliter le partage et ouvrir le dialogue, favoriser les échanges avec les gens « sains » qui, peut-être, ne verront plus dans le trouble psychique une bombe à retardement prête à exploser avec pertes et fracas.
Références
[1] Pirkis J., Blood R., Francis C., Mccallum K. « A review of the literature regarding fictional film and television portrayals of mental illness » (2005).
[2] L. A. Teplin, G.M. McClelland, K.M. Abram, & D.A. Weiner, « Crime victimization in adults with severe mental illness: comparison with the National Crime Victimization Survey ». Archives of general psychiatry, 2005.
[3] J.-L. Dubreucq, C. Joyal, F. Millaud, « Risque de violence et troubles mentaux graves », Annales Médico Psychologiques, 2005. Cités par Virginie De Baeremaeker et Pierre Schepens dans leur article « Tous fous, tous dangereux », CBCS.
[4] C. Tassone-Monchicourt, N. Daumerie, A. Caria, I. Benradia, J.-L. Roelandt, « États dangereux et troubles psychiques : images et réalités », L’Encéphale, Supplément 1 au N°3, décembre 2010.
[5] Interrogé par Theo Chapuis, « La pop culture est passionnée de psychiatrie — et c’est la preuve qu’elle n’est plus si tabou que ça », 7 février 2018
[6] « Byron to Batman: The Pop Culture Problem of Romanticizing Mental Illness », TEDxUGA, 30 mars 2016 ; voir aussi notre analyse « L’artiste et le “fou” : frères d’armes ou frères ennemis », 22 novembre 2021.
[7] David Lambert, « L’Effet Werther, l’œuvre de Goethe a-t-elle provoqué une vague de suicides en Europe ? », février 2022.
[8] « Prévention du suicide : une ressource pour les professionnels des médias », 2017.
[9] Interrogé par Clément Guillet, « Le morceau du rappeur Logic a sans doute permis d’éviter plusieurs centaines de suicides », 28 décembre 2021.
[10] Extrait du web-documentaire « Internement » de l’Autre « lieu » – RAPA.
[11] Interrogé par Alexandra Sifferlin, « Homeland and Bipolar Disorder: How TV Characters Are Changing the Way We View Mental Illness », 8 octobre 2013.