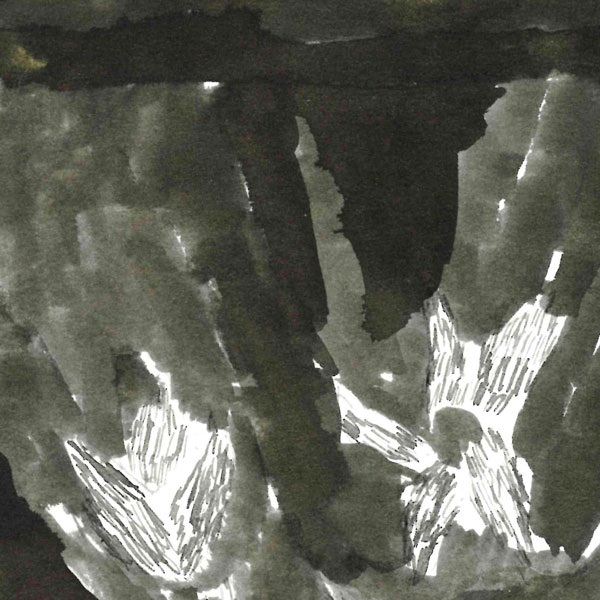Le fantasme de changer l’Autre
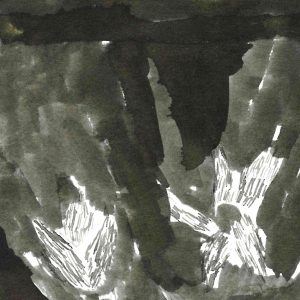
Auteur : Catherine Thieron, animatrice au Centre Franco Basaglia
Résumé : La cohabitation entre différentes espèces animales est vieille comme le monde, et l’humain se targue d’en avoir domestiquées plusieurs.[1] Mais peut-on encore parler de cohabitation quand il est attendu de l’Autre – humain ou non-humain – qu’il soit contenu, docile, obéissant ?
Temps de lecture : 15 minutes
Mon chat, c’est ma chouquette, ma choucroute garnie, ma chipolata. En revanche, ce n’est ni mon bébé, ni mon amoureux : c’est un colocataire un peu revêche, et il doit penser la même chose de moi. Et puisque c’est un chat, c’est une vraie tête de con ; je le savais en l’accueillant chez moi. Normal : c’est un con de chat, c’est ainsi que je l’aime, et parce que je suis responsable de lui, son bien-être dépend de moi.
Pourtant, des tas de gens semblent oublier que leur animal de compagnie possède une vie qui lui est propre et qu’il n’est pas là pour combler les besoins et désirs de son « maître » ou de sa « maîtresse ». Plutôt que de prendre le nouvel arrivant tel qu’il est, avec ses singularités, ce dernier doit changer pour s’adapter à une vie bien rangée qui n’est pas la sienne : après tout, on a ses petites habitudes, et ce n’est tout de même pas un chat ou un chien qui va venir les bousculer… avec tout ce qu’on fait pour eux !
Et puisque l’animal non-humain ne changera pas sa nature pour nos beaux yeux, il peut être bien plus facile et confortable de le mettre sous camisole chimique plutôt que de s’assurer que son environnement lui convienne autant qu’à nous…
Camisoles chimiques pour animaux domestiques
« On est parties de la dépression chez l’humain, explique Mira Goldwicht en préambule du documentaire radiophonique « Zoo Pharmakon® » qu’elle a coréalisé avec Sarah Fautré, puis on a remarqué que quand les humains et les animaux ne vont pas bien, on leur donne les mêmes médicaments. Donc, on fait un lien entre les animaux, les humains et les médicaments, mais on n’est pas super à l’aise avec ce lien-là. »[2]
Partant de ce constat, elles sont allées à la rencontre de philosophes, psychologues et vétérinaires…
Un nombre croissant d’individus préfèrent mettre leurs animaux de compagnie sous antidépresseurs ou anxiolytiques plutôt que de changer leurs propres habitudes ou adapter leur environnement. À titre d’exemple, un border collie a besoin de courir en extérieur plusieurs heures par jour et se sentira terriblement à l’étroit, pour ne pas dire oppressé, dans un appartement en milieu urbain. Pour lisser des pulsions jugées envahissantes par l’humain, voire agressives, la médication peut être la solution la plus séduisante puisque la plus rapide, et donc la plus confortable pour le cohabitant bipède.
Étrangement, ce dernier n’envisage pas cet acte comme une psychiatrisation de l’animal, et l’industrie pharmaceutique ne s’y trompe guère puisqu’elle « utilise des vieux médicaments à usage humain qui ont été recyclés sur le chien. Ça donne une deuxième vie à ces médicaments qui, sinon, seraient tombés quasiment dans l’oubli. Les dosages chez l’animal sont généralement cinq à dix fois supérieurs aux dosages humains[3], et donc on arrive vite aux effets secondaires. », observe Joël Dehasse, vétérinaire comportementaliste interrogé dans « Zoo Pharmakon® ». Il poursuit qu’il reçoit très peu de consultations pour dépression « parce que l’animal qui est déprimé, il ne bouge pas de son sofa, il ne gêne pas, il ne détruit pas, il n’aboie pas, il ne pose pas de problèmes. Et donc, les gens ne viennent pas en consultation avec un chien qui ne leur pose pas de problèmes. […] 95% des gens viennent parce que eux ne vont pas bien et qu’il faut changer l’autre pour que eux aillent bien. »
Changer l’autre plutôt que de changer soi-même, ce fantasme vieux comme l’Humanité… Selon l’anthropologue Dan Sperber « [d]ès lors que vous avez des états mentaux dans votre ontologie, et la capacité d’attribuer à autrui de tels états mentaux, il n’y a guère plus d’un pas à franchir pour que vous ayez des désirs sur ces états mentaux – le désir qu’elle croie ceci, le désir qu’il désire cela – et pour que vous formiez l’intention de modifier les états mentaux d’autrui. »[4]
L’illusion de maîtriser
Il est intéressant de noter que les molécules sont rigoureusement les mêmes que celles utilisées pour combattre la dépression ou l’hyperactivité chez l’humain puisque celles-ci ont été testées sur des animaux non-humains. Il n’est donc pas impossible qu’un vétérinaire prescrive de la fluoxétine (le célèbre Prozac) à Poussy ou Mirza, jugé incontrôlable – ou tout du moins gênant – par son humain. Pour Vinciane Despret, philosophe des sciences, donner ce type de molécules aux animaux est une reconnaissance qu’ils sont capables d’états subjectifs et émotionnels complexes.[5]
Hélas, « on ne voit pas vraiment l’Autre, estime le biologiste Yves Christen, surtout quand le raisonnement s’en tient aux catégories établies : son étiquette le désigne mieux que la réalité. Même quand on le connaît bien. Cela vaut quand cet Autre est humain, plus encore quand il est animal. Le refus du concept de personne animale apporte, de ce point de vue, toutes les justifications pour faire à la bête ce que l’on veut, mû par l’unique soucis de notre intérêt personnel. » Cependant, « [s]eule l’ignorance peut désormais faire croire qu’ils ne sentent ou ne ressentent rien. Ou que leurs sentiments n’ont guère d’importance. Pourtant, même dans un monde où la connaissance devrait être la règle, des pratiques subsistent qui témoignent de la difficulté à faire entrer un tel savoir dans notre gestion de la vie animale. [À] l’heure de procéder selon les us et coutumes de la « rationalité » humaine, seules semblent entrer en ligne de compte des contingences pratiques. Dans la plupart des cas, nous répondons à la formidable richesse émotionnelle des bêtes par une pauvreté affective d’autant plus terrifiante que le secours de la technique nous donne l’illusion de maîtriser les solutions. »[6]
La vérité est que les antidépresseurs et les anxiolytiques ne sont pas utilisés pour soigner la dépression en médecine vétérinaire, mais pour empêcher les animaux domestiques de (se) blesser ou d’endommager des biens, entretenant ainsi l’illusion qu’il s’agit là de pilules magiques capables d’adoucir un soi-disant mauvais caractère. Or, la clé pour guérir les problèmes de comportement est d’avoir la patience et la détermination nécessaires pour apporter aux animaux de compagnie le meilleur environnement possible, un environnement véritablement adapté à leurs besoins et non exclusivement à ceux de leur « maître ». D’ailleurs, la recherche soutient l’idée que les facteurs environnementaux jouent un rôle prépondérant dans le développement, mais aussi dans la résolution des problèmes de comportement chez les animaux de compagnie.[7] Sans surprise, ces études suggèrent que les chiens qui ne sont promenés que quelques fois par semaine ou dont les propriétaires sont peu présents peuvent être plus à même de présenter une agitation excessive ou de s’adonner à des actes de destruction.
Mais le but est-il réellement de soigner des troubles du comportement, ou d’avoir à domicile un objet décoratif de plus ?
Être responsable
La notion de « maître » implique un grand pouvoir sur autrui, et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Joseph Gatugu explique que l’usage classique de la responsabilité « s’inscrit dans le champ juridique où il réfère à l’imputation d’une action à un auteur et, éventuellement, à la sanction ou à la réparation. Un autre usage de la responsabilité (…) s’inscrit dans le champ éthique où il réfère à la sollicitude ou au souci pour l’Autre vulnérable en ma charge. Cette responsabilité est exigence morale : exigence du prendre soin, de responsabilisation, de capacitation et d’autonomisation de la personne vulnérable prise en charge. » Cette exigence morale est sollicitude et répond à « une mission confiée de prendre soin de l’Autre vulnérable dont les capacités sont réduites, diminuées ou altérées. Concept relationnel, ce type de responsabilité s’inscrit dans un espace de coresponsabilité où la personne vulnérable participe à sa prise en charge dans une visée d’autonomie et de vie bonne. En cela, elle est capacitante et épanouissante. Elle s’oppose ainsi radicalement à la responsabilité assistanat où les personnes prises en charge sont maintenues dans la dépendance ».[8]
Il arrive aussi que la responsabilité, par le sentiment de contrôle réel ou fantasmé qu’elle octroie, puisse mener un individu à projeter sur l’Autre vulnérable – ou perçu comme tel – ses propres désirs et besoins. Plutôt que d’accorder à l’Autre une place qui lui est propre et unique, en s’assurant de son bien-être au sein d’un environnement accueillant, il devient un prolongement de soi ; il n’existe plus par lui-même, et cet « oubli de la reconnaissance » devient réification, décrite par le philosophe Axel Honneth comme « le processus par lequel, dans notre savoir sur les autres hommes et la connaissance que nous en avons, la conscience se perd de tout ce qui résulte de la participation engagée et de la reconnaissance. »[9]
Amputé de ses désirs, contenu dans ses gestes et dans ses émotions, le sujet devient objet. Un faire-valoir, en somme. Pour ne pas déranger, il apprend à se soumettre et à se conformer, et perd petit à petit le contact avec lui-même en tant qu’individu…
C’est particulièrement vrai dans la prise en charge du trouble psychique, où l’empathie tend à s’effacer derrière un système que Mathieu Bietlot qualifie de « disciplinaire » : « avec ses réglementations, ses prescriptions de ce qui est attendu des patients, ses critères d’admission et d’exclusion, [ce système] est lourd d’effets normalisateurs et contredit l’hospitalité éthique qui, inconditionnelle et absolue, reçoit l’autre sans lui ôter son altérité, sans attendre qu’il se conforme aux règles de la maison. Elle l’accepte comme étrange, comme intrigant, comme inconnu, même comme hostile, sans chercher à l’assimiler ou à le ramener à du connu.
L’hospitalité ainsi réglementée procède à l’inverse de l’hospitalité antique : la personne doit d’abord être identifiée précisément, diagnostiquée conformément, pour avoir droit à l’hospitalité ».[10]
Rendre « acceptable »
Au sujet des effets normalisateurs, Olivier Croufer constate que, « en situation, il y a toujours un problème avec la norme. L’homme normal, qu’il soit dans un régime disciplinaire ou de normalisation, s’efforce plus ou moins délibérément de répéter la norme ». Ce même homme, cependant, « introduit un léger trouble dans la norme en même temps qu’il vit un léger trouble en lui-même par l’actualisation déviée, aménagée de cette norme. Le problème prend de l’ampleur quand ça résiste plus intensément, quand les forces existentielles d’un sujet ne se mettent plus vraiment dans les formes (savoirs, organisations spatio-temporelles, conduites modèles, …) des dispositifs disciplinaires ou de normalisation. »[11]
Parfois, la résistance à la norme est telle que l’adaptation à l’environnement passe par la contrainte, et l’inquiétude d’une dépendance excessive aux psychotropes pour aider les animaux – humains et non-humains – à s’adapter à des situations où ils sont en décalage ou dans lesquelles ils n’ont simplement pas à se trouver est parfaitement fondée. Bien que les médicaments puissent être utiles dans certains cas, la tendance à prescrire des molécules pour aider à faire face à des environnements défavorables au bien-être et au développement serein de l’individu est une préoccupation éthique sur laquelle toutes les parties responsables devraient se pencher. Chez les humains, « le médicament est devenu la manière de supporter l’insupportable du social et du travail. Et comme on ne va pas changer le monde du travail, on va changer le ressenti », estime le philosophe et psychanalyste Luc Richir.[12] Chez les animaux de compagnie, le médicament imposé est une manière de le rendre plus docile, malléable, et même passif. Jadis, les méthodes pour parvenir à ce résultat étaient d’une dureté remarquable ; aujourd’hui, quelques cachets suffisent, et la conscience est tranquille.
C’est là, aussi, que l’on réalise à quel point la reconnaissance de l’Autre – qu’il soit animal de compagnie, patient, enfant, conjoint, collègue… –, de ses besoins, de son self, de sa singularité est loin d’être acquise, et il arrive que la moindre déviation de ce qui est attendu de l’individu extérieur devenu élément perturbateur soit bridée, domptée, contenue pour ramener l’insolente créature dans les clous d’un comportement jugé acceptable.
Encore faudrait-il s’entendre sur ce qu’est un comportement « acceptable »…
[1] Sauf les chats qui, eux, se sont domestiqués tout seuls.
[2] « Zoo Pharmakon® », de Sarah Fautré et Mira Goldwicht, 2018.
[3] Une molécule dont l’effet est antidépresseur chez l’humain doit être administrée à très haute dose pour avoir un effet anti-agressif chez le chien.
[4] Dan Sperber, « La Contagion des idées », Odile Jacob, 1996.
[5] In « Zoo Pharmakon® », de Sarah Fautré et Mira Goldwicht, 2018.
[6] Yves Christen, « L’animal est-il une personne ? », Flammarion, 2009.
[7] I.R. Dinwoodie, V. Zottola, N.H. Dodman, « An investigation into the effectiveness of various professionals and behavior modification programs, with or without medication, for the treatment of canine aggression », 2021.
[8] Joseph Gatugu, « Une responsabilité attentive aux capacités », 1er décembre 2017.
[9] Axel Honneth, « La réification. Petit traité de théorie critique », traduit de l’allemand par Stéphane Haber, Gallimard, 2007.
[10] Mathieu Bietlot, « Hospitalité – Procuste et les lits psychiatriques », 29 octobre 2019.
[11] Olivier Croufer, « Les troubles embarqués des horizons normatifs », 18 mars 2020.
[12] In « Zoo Pharmakon® », de Sarah Fautré et Mira Goldwicht, 2018.