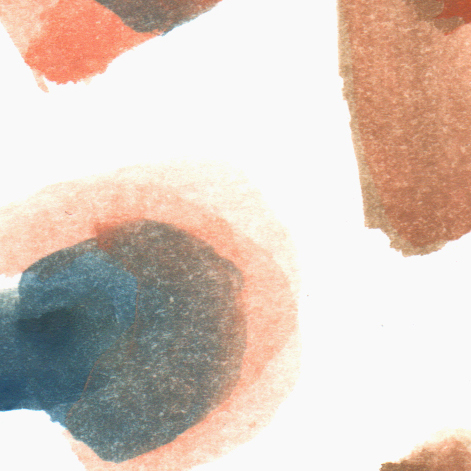L’hôte d’Albert Camus
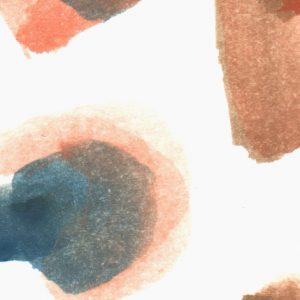
Auteur : Olivier Croufer, coordinateur du plaidoyer socio-politique au Centre Franco Basaglia
Résumé : « Scènes pour des politiques d’hospitalité » sont des textes d’analyse qui tentent de réfléchir aux mouvements que les histoires d’hospitalité induisent dans les rapports humains. Dans L’hôte d’Albert Camus, l’hospitalité est la scène d’une hésitation. Elle raconte la fragilité d’une fraternité qui hésite entre tendresse, solidarité et une distance qui dit la solitude de l’hôte. L’hospitalité crée un lieu très particulier qui rend visible ce double élan, quelque peu paradoxal.
Temps de lecture : 15 minutes
« Scènes pour des politiques d’hospitalité » sont des textes d’analyse qui tentent de réfléchir aux mouvements que les histoires d’hospitalité induisent dans les rapports humains. Ces analyses sont construites à chaque fois selon le même schéma. Une scène est extraite d’une œuvre littéraire, plastique, poétique, … Elle est présentée en début d’article. Nous essayons ensuite de qualifier les hôtes : quels noms portent-ils, quelles sont leurs qualités ? Enfin, nous nous demandons en quoi cette scène d’hospitalité questionne et transforme les rapports humains, voire invite à de nouvelles politiques.
Daru, un instituteur, vit seul sur l’immense étendue d’un haut-plateau caillouteux d’Algérie. La neige est tombée brutalement après huit mois de sécheresse. Les élèves ne viennent plus à l’école. Au loin, deux hommes arrivent. Un gendarme sur son cheval, le vieux Balducci, un Corse. Derrière lui, au bout d’une corde, marche un prisonnier arabe. Daru les accueille dans son école. Balducci dépose le prisonnier chez l’instituteur en lui donnant l’ordre de l’amener à la police de Tinguit le lendemain.
Des hôtes qui ne se comprennent pas
Cette scène est extraite de la nouvelle d’Albert Camus, L’hôte[1]. Celle-ci appartient à un recueil de 6 nouvelles, écrites entre 1952 et 1954, et publiées sous le titre de L’exil et le Royaume. Ce sera la dernière œuvre publiée du vivant d’Albert Camus (1913-1960).
L’hôte désigne le prisonnier arabe déposé chez Daru. Mais le lecteur hésite, affecté par le double sens du mot hôte en français qui désigne à la fois la personne accueillie (« guest » en anglais) et la personne qui reçoit (« host » en anglais). L’hôte peut donc tout aussi bien être Daru, celui qui offre l’hospitalité. Et dans ce paysage où ne poussent que les pierres, ce pays rude, « cruel à vivre, même sans les hommes, qui, pourtant, n’arrangeaient rien[2] », le lecteur se demande si Daru n’est pas aussi l’hôte transitoire de la nature.
Daru a les gestes que l’on attend d’habitude d’une hospitalité. Respectant la tradition arabe, il offre le thé à la menthe à ses invités. Quand il s’approche du prisonnier, il se rend compte que ses mains sont toujours attachées. Il s’agenouille devant lui et les délie pour qu’il puisse boire son thé. Une fois le gendarme parti, il lui prépare une galette de farine, une omelette, il lui présente des dattes et du fromage. L’hospitalité s’exprime humblement. Le soir, il installe un lit de camp et une couverture pour son hôte qu’il accueille dans sa chambre.
Le lendemain matin, Daru accompagne l’hôte à la croisée des chemins où il le laissera s’en aller. Il lui offre un paquet avec des dattes, du pain et du sucre grâce auxquels il pourra tenir deux jours. Il lui donne également mille francs.
Le lecteur a le sentiment d’un accueil sobre et bien réel. Mais en même temps, il se pose des questions sur cette hospitalité. Il existe une distance problématique dans cette relation. La plus manifeste est l’absence de prénom de la personne accueillie qui restera durant toute la nouvelle appelée « prisonnier » ou l’ « Arabe ». Balducci le désignera par « le camarade » ou « ce zèbre », mais jamais ce personnage ne sortira de l’anonymat. Ce qui fait une rencontre singulière ne se produit pas. La description que fait le narrateur du prisonnier est d’ailleurs plutôt stéréotypée : les pieds dans des sandales, vêtu d’une djellaba, coiffé d’un chèche, et un corps correspondant à l’ethnotype arabe, des lèvres énormes, des yeux sombres, une peau recuite.
Malgré que Daru s’adresse en arabe au prisonnier qui ne parle pas français, les deux hommes ne se comprennent pas. Quand la conversation pourrait atteindre un tour plus personnel, plus engagé, elle ne prend pas :
« – Pourquoi tu l’as tué ? dit-il (dit Daru) d’une voix dont l’hostilité le surprit.
L’arabe détourna son regard.
– Il s’est sauvé. J’ai couru derrière lui.
Il releva les yeux sur Daru et ils étaient pleins d’une sorte d’interrogation malheureuse.
– Maintenant, qu’est-ce qu’on va me faire ?
– Tu as peur ?
L’autre se raidit, en détournant les yeux.
– Tu regrettes ?
L’arabe le regarda, bouche ouverte. Visiblement, il ne comprenait pas[3]. »
La même incompréhension se présente au moment crucial de la nouvelle où Daru, après avoir accompagné quelques moments le prisonnier, s’arrête à la croisée des chemins, lui donne un paquet de victuailles et le laisse choisir sa destinée :
« L’Arabe prit le paquet et l’argent, mais il gardait ses mains pleines à hauteur de la poitrine, comme s’il ne savait que faire de ce qu’on lui donnait. « Regarde maintenant, dit l’instituteur, et il lui montrait la direction de l’est, voilà la route de Tinguit. Tu as deux heures de marche. A Tinguit, il y a l’administration et la police. Ils t’attendent. » L’Arabe regardait vers l’est, retenant toujours contre lui le paquet et l’argent. Daru lui prit le bras et lui fit faire, sans douceur, un quart de tour vers le sud. Au pied de la hauteur où ils se trouvaient, on devinait un chemin à peine dessiné. A un jour de marche d’ici, tu trouveras les pâturages et les premiers nomades. Ils t’accueilleront et t’abriteront selon leur loi. » L’Arabe s’était retourné maintenant vers Daru et une sorte de panique se levait sur son visage : « Écoute », dit-il. Daru secoua la tête : « Non, tais-toi. Maintenant, je te laisse. » Il lui tourna le dos, fit deux grands pas dans la direction de l’école, regarda d’un air indécis l’Arabe immobile et repartit.[4] »
Alors que l’Arabe s’apprête à s’engager dans une parole – « écoute » dit le prisonnier au moment où il va devoir saisir la liberté que lui propose Daru – celui-ci interrompt la rencontre qui n’a jamais vraiment pu avoir lieu.
* * * *
Que nous dit cette nouvelle de l’hospitalité ? Car le lecteur a l’impression que l’hospitalité raconte quelque chose d’une situation, d’une histoire, d’un rapport entre les hommes.
Une fraternité hésitante
L’hospitalité parle au cœur d’une tension, d’un écart. L’analyste Fernando Gomez parle d’un dilemme qui traverse l’ensemble des nouvelles de L’exil et le royaume dont L’hôte est extrait. « Les héros camusiens (y) sont tous confrontés au dilemme « solitaire ou solidaire », qu’ils aspirent à la communication avec l’autre et le monde, bref, au royaume, mais se trouvent face à un triple isolement – géographique, politique et psychologique – qui s’avère être l’essence de leur exil. [5] » « C’est, sans nul doute, dans la nouvelle « L’Hôte », nommément dans l’ethos du héros camusien, Daru, que l’ambigüité entre solitaire et solidaire est le plus fortement présente[6]. »
L’isolement de l’instituteur est déjà géographique. L’école est située sur « une étendue solitaire où rien ne rappelait l’homme. »[7]. Plus loin, au-delà du haut-plateau où il habite, « on pouvait apercevoir les masses violettes du contrefort montagneux où s’ouvrait la porte du désert. »[8]
Daru s’isole politiquement, ou plutôt, il se distancie, ne s’engage jamais pleinement pour une des parties en conflit alors que débute la guerre d’Algérie[9]. Pour une part, il est pleinement dans le camp des Français. Dans la classe de l’école, « sur le tableau noir (…) quatre fleuves de France, dessinés avec quatre craies de couleurs différentes, coulaient vers leur estuaire depuis trois jours. »[10] Quand il demande au gendarme Balducci le motif de l’arrestation du prisonnier, Daru formule sa question d’une façon qui dit clairement son camp : « Il est contre nous ? »[11] Et par ailleurs, l’instituteur français, se démarque des injonctions de l’administration française. Il refuse de livrer le prisonnier à la police de Tinguit, malgré que « ce sont les ordres »[12], comme le lui rappelle le gendarme. Le lendemain, il ne conduira pas l’Arabe à la police, il lui laisse la liberté de choisir son chemin, mais il ne le conduira pas non plus jusqu’aux nomades qui pourront l’accueillir et l’abriter selon leur loi.
La solitude est dès lors évidemment psychique. La nouvelle se termine sur cette phrase : « Daru regardait le ciel, le plateau et, au-delà les terres invisibles qui s’étendaient jusqu’à la mer. Dans ce vaste pays qu’il avait tant aimé, il était seul.[13] »
Par ailleurs, Daru ne vit pas que seul. Il se lie aux gens avec lesquels il cohabite au travers de valeurs et de gestes de solidarité. Chaque jour, il distribue une ration de blé aux élèves dont les familles étaient victimes de la sécheresse. Et malgré ce ravitaillement, « il serait difficile d’oublier cette misère, cette armée de fantômes haillonneux errant dans le soleil, les plateaux calcinés mois après mois, la terre recroquevillée peu à peu, littéralement torréfiée, chaque pierre éclatant en poussière sous le pied.[14] » Une complicité semble s’établir entre les personnages grâce au paysage, à l’ambiance de la terre. « Dans ce désert, personne, ni lui ni son hôte n’étaient rien. Et pourtant, hors de ce désert, ni l’un ni l’autre, Daru le savait, n’auraient pu vivre vraiment.[15] »
Le lecteur ressent ces doubles élans de solitude et de solidarité, et il flotte dans cet écart. Mais la fraternité ne se déploie jamais. La présence de l’Arabe irrite Daru, elle le gène. Alors qu’ils dorment côte à côte, il considère ces moments de proximité fraternelle comme une « bêtise » : « Dans la chambre où, depuis un an, il dormait seul, cette présence le gênait. Mais elle le gênait aussi parce qu’elle lui imposait une sorte de fraternité qu’il refusait dans les circonstances présentes et qu’il connaissait bien : les hommes, qui partagent les mêmes chambres, soldats ou prisonniers, contractent un lien étrange comme si, leurs armures quittées avec les vêtements, ils se rejoignaient chaque soir, par-dessus leurs différences, dans la vieille communauté du songe et de la fatigue. Mais Daru se secouait, il n’aimait pas ses bêtises, il fallait dormir.[16] »
Une béance difficile
L’hospitalité devient alors un espace d’interrogation. Elle ouvre une béance qui interroge. Jeanyves Guérin, professeur de littérature dans une université française, pose le drame de cet abîme. « L’hôte reste l’autre. Parler sa langue est une chose, se faire comprendre de lui en est une autre. La brève rencontre se solde par un fiasco. Le choc des cultures est flagrant et la barrière de civilisation infranchissable. La communication est difficile et la communion manquée. L’égalité et la fraternité, les valeurs républicaines de Daru se sont révélées abstraites, indicibles[17]. » Puis s’autorisant à déborder de son rôle d’analyste, il s’implique dans l’interrogation dans laquelle nous propulse la nouvelle. Il cherche des voies. « Peut-être manque t’il à Daru, instituteur sans livres, d’avoir lu Le Petit Prince et médité sa leçon. Avant de connaître l’autre, il faut l’apprivoiser. « C’est une chose trop oubliée, dit le renard, ça signifie « créer des liens » ». Cela exige du temps, de la patience, des rites. »[18] Puis ailleurs il hésite, il semble poser ses questions à de tout autres niveaux de relations : « L’hôte fictionnalise la difficile relation entre le colonisateur et le colonisé.[19] » L’hospitalité interroge nos relations dans une histoire plus vaste qu’une rencontre d’homme à homme où la proposition du renard du Petit Prince paraît minuscule.
Pour Anabel Herzog, l’hospitalité de Daru laisse ouverte une question politique que certains reprochent d’ailleurs à Camus de ne pas trancher. L’Arabe a tué son cousin. Probablement pour une affaire de grain que l’un devait à l’autre. « Ça n’est pas clair », dit Balducci. La nouvelle nous interroge : « qui doit juger l’Arabe ? Qui peut le juger ? Le colon français ? Le village arabe ? Les nomades neutres ou même indifférents ? L’Arabe demande à Daru : « C’est toi le juge ?[20] ». Non seulement Daru n’est pas le juge, mais en plus il ignore qui est le juge et c’est la raison pour laquelle il laisse l’Arabe choisir sa route. Daru cherche en vain une réponse à la question : où est le juge ?[21] »
La lecture de la nouvelle par Lila Ibrahim-Lamrous suscite, chez elle aussi, un espace d’interrogation ouvert par l’hospitalité. Cet espace flotte entre questions macro-politiques et recherches existentielles. « L’hospitalité offerte par Daru condamne celui-ci à réinterroger ses certitudes et ses principes, l’ouvre au questionnement inquiet sur ses valeurs et son éthique. Cette relation d’accueil de l’Autre est aussi une relation d’accueil de soi, un soi non expurgé de ses contradictions et de ses angoisses.[22] » Et les questions ouvertes par Daru deviennent aussi celles du lecteur.
En somme, au-delà d’un geste d’accueil, l’hospitalité est la scène d’une hésitation. Elle raconte la fragilité d’une fraternité qui hésite entre tendresse, solidarité et une distance qui dit la solitude de l’hôte. L’hospitalité crée un lieu très particulier qui rend visible ce double élan, quelque peu paradoxal. Elle ouvre alors des questions qui autrement seraient peut-être restées silencieuses, ici sur la justice, là sur des rapports coloniaux. Elle les ouvre et n’y répond pas.
Références
[1] Camus Albert, L’hôte, in L’exil et le royaume, Paris, Gallimard, Collection Folio, 2014.
[2] Camus A., op. cit., p. 83.
[3] Camus A., op. cit., pp. 92-93.
[4] Camus A., op. cit., p. 98.
[5] Gomez, Fernando , « Solitaire ou solidaire » dans l’Exil et le Royaume d’Albert Camus, in Carnets, Revue électronique d’Études Françaises, IIème série, no 4, mai 2015, p. 63-76.
[6] Gomez Fernando, op. cit. p. 71.
[7] Camus A., op. cit. , p. 87.
[8] Camus A., op. cit. , p. 82.
[9] La guerre d’Algérie (1954-1962) débute en novembre 1954 lorsque les différentes factions du nationalisme algériens réunies sous la bannière du Front National de Libération lancent une insurrection contre la France, pays colonisateur depuis 1830. Les nouvelles de L’exil et le Royaume ont, quant à elles, été écrites entre 1952 et 1954.
[10] Camus A., op. cit. , p. 81.
[11] Camus A., op. cit. , p. 87.
[12] Camus A., op. cit. , p. 86.
[13] Camus A., op. cit. , p. 99.
[14] Camus A., op. cit. , p. 83.
[15] Camus A., op. cit. , p. 91.
[16] Camus A., op. cit. , p. 94.
[17] Guérin Jeanyves, L’autre comme hôte dans les derniers écrits algériens de Camus, in Gauvin L., L’Hérault P. et Montandon A., Le dire de l’hospitalité, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2004, p. 148.
[18] Guérin J., op. cit., p. 148.
[19] Guérin J., op. cit., p. 155.
[20] Camus, op. cit., p. 92.
[21] Herzog Anabel, Paradigmes bibliques, colonialisme et hospitalité dans “L’hôte” de Camus, in Études françaises, vol. 42, n° 2, 2006, p. 137-147, p. 140.
[22] Ibrahim-Lamrous, Lila, L’Exil et le Royaume d’Albert Camus, l’Algérie comme chair de la poésie, in Lendemains, n° coordonné par M. Trabelsi, université d’Onasbruck, n° 128, Avril 2009, p. 152.