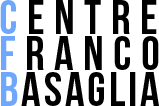Le portrait photographique comme geste d’hospitalité

Auteur : Julien Vanderhaeghen, animateur au Centre Franco Basaglia
Résumé : Le portrait photographique peut-il favoriser l’hospitalité ? Que cela soit au moment de la prise de vue, entre le/la photographe et le sujet ; ou bien plus tard entre le/la spectateur.trice de cette photo et sa réaction à un.e inconnu.e.
Temps de lecture : 25 minutes
Voilà un an qu’un groupe d’arpentage photographique existe au Centre Franco Basaglia, partant une fois par mois dans les rues et les quartiers de Liège, quelque part entre l’exploration urbaine et l’enquête photographique : « Comment un lieu fait-il hospitalité ? Comment accueille-t-il des personnes ? Comment ouvre-t-il à des histoires et des imaginaires ? Comment habiter un lieu pour soi, avec les autres et ce qui nous environne ? Quel regard je porte sur ces espaces avec un appareil photo ? »
Nous avons d’abord arpenté les rues afin d’observer et d’interroger l’espace avec notre regard de photographe, un peu comme ce mouvement photographique de « la nouvelle topographie[1] » qui observait le territoire. Mais dès le départ, il existait dans le groupe une sensibilité à la photographie humaniste qui donna rapidement l’apport de portraits de rue dans notre recherche collective, invitant à se poser la question des « gestes d’hospitalité » des habitant.es de la ville. Alors a surgi en moi une question : « Le portrait photographique peut-il favoriser l’hospitalité ? »
Quel type d’hospitalité ?
« L’hospitalité commence avec une sensibilité à la vulnérabilité d’autrui.[2] » Il faut donc d’abord une certaine sensibilité et c’est peut-être le point de départ du/de la photographe, partir avec sa sensibilité dans un territoire et y être touché.e par les personnes qu’il/elle rencontre. L’hospitalité ne serait plus alors juste « l’accueil sans réserve ni calcul[3] », mais consisterait davantage dans le fait de s’ouvrir et d’accepter le trouble d’une rencontre. Un.e photographe est touché par une personne, l’approche et la photographie. Parfois, il y a échange, une rencontre a lieu, parfois troublante, parfois touchante, mais une rencontre qui marque souvent le/la photographe et le/la déplace hors de lui/elle pour entrer dans un autre univers : celui de la personne rencontrée.
Dans ce geste photographique, il y a une reconnaissance de la singularité d’un individu. Par ce portrait, le/la photographe reconnaît quelque chose et quelqu’un.e. Un individu unique qui a attiré son regard, qui porte en lui quelque chose. Mais il peut aussi y avoir la reconnaissance d’un décalage par rapport à la norme. Ce que chacun.e d’entre nous vit certainement en son corps propre, perçoit aussi chez les autres et qui prend la forme ici d’un portrait.
« J’ai une curiosité fondamentale pour le sujet humain, en particulier pour les personnes marginalisées. Je crois qu’en faisant des photos, les spectateurs ont la possibilité de s’intéresser à ces sujets eux aussi[4] », nous dit Dawoud Bey, qui cherche à valoriser la communauté afro-américaine par sa photographie.
C’est probablement à cette dimension de l’hospitalité que nous invite un portrait : se rendre sensible à une singularité et y porter attention.
Quels types de portraits ?
En photographie, on partage souvent le portrait en deux camps : le portrait volé et le portrait posé. En caricaturant, l’un est censé montrer quelque chose de naturel alors que l’autre serait l’image sociale que cherche à renvoyer le/la portraituré.e. Le portrait posé, frontal, regard braqué vers l’objectif, est le portrait typique de la photographie documentaire. Prenant sa défense, Lionel Trilling dit ceci : « Non seulement la pose dit plus que ce qui pourrait être dit avec un sujet non conscient de l’appareil, mais le modèle gagne en dignité quand il lui est permis de se défendre contre l’objectif[5] ». Dawoud Bey, parlant de son propre travail, dit : « Ces portraits de rue formels mais décontractés deviennent un espace où les sujets noirs peuvent s’affirmer dans le monde, leur regard rencontrant celui du spectateur sur un pied d’égalité.[6] » Voilà qui est intéressant ! Le/la portraituré.e participe à la photo, il/elle en devient acteur.trice et peut choisir l’image qu’il/elle veut renvoyer. Lincoln Kirstein complète ce point de vue en disant : « L’autoreprésentation ne fait-elle pas aussi partie de la “vie” ? [7] »
Portrait volé ou posé, l’un comme l’autre peut s’entourer, ou pas, d’informations contextuelles. Celles-ci nous aideront à savoir où est la personne, ce qu’elle peut y faire, le contexte social, etc. On a des éléments pour se faire une histoire. « On rentre dans l’univers d’un autre », nous dit Sébastien B, quand je fais enquête auprès du groupe d’arpentage[8]. Grâce au contexte, « On peut s’y projeter plus facilement » me dit Fabrice B, « mais le portrait posé limite mon imaginaire », ajoute-t-il. Le contexte aide, mais l’aspect posé peut donc déranger certains. À l’inverse, pour d’autres, comme Louise W, le cadrage plus serré va inviter à se concentrer sur le visage de la personne, ou son regard. Et on peut en être profondément touché[9]. Pour Fabrice W, les deux types de portraits invitent à des choses différentes. « Le regard de front, perçant, t’attrape. Et tu as l’impression de rentrer dans l’âme du gars. Et puis tu as les autres portraits, où les gens sont dans une action, un contexte, et là tu n’es plus dans la personnalité de la personne mais dans les histoires et le contexte. » Dans un cas comme dans l’autre, on se décentre, on se projette dans un autre univers. « Quand je regarde un portrait, je suis en interaction avec la personne sur la photo. J’y projette toujours quelque chose. (…) La photo amène des infos qu’on interprète à partir de son propre univers », complète Louise W.
Après ces échanges, je me suis posé la question suivante : « Y a-t-il réellement un type de portrait meilleur qu’un autre ? Mais ce n’est peut-être pas la bonne question. Alors je vais vous rendre votre rôle actif de regardant.e en reformulant comme ceci : « Lequel vous touche le plus ? » Pour ma part, j’aime les deux pour des raisons différentes d’écriture photographique ou d’usage. Mais, tout comme Louise, j’avoue qu’un portrait plus resserré avec un arrière-plan flou me touche souvent, m’invitant à me centrer sur la personne.
Le point de vue du/ de la regardant.e : qu’est-ce qui touche dans un portrait ?
On peut donc être aspiré.e par un regard. Un regard direct qui attire notre attention, l’appelle. On s’y plonge. On est pris par l’humanité de la personne, par son être, son existence de vivant. Il est là. Elle est là. Il existe. Elle existe. Ce n’est plus une abstraction. Le regard est ce qui vient provoquer une résonance en nous. On peut l’expliquer par les neurosciences et tout ce qui a été écrit autour des neurones miroirs. Mais on peut aussi se servir des mots du sociologue allemand Hartmut Rosa : « […] le regard de l’autre – qu’il soit inquiet, brisé, vide, triste, absent, méfiant, fermé, ou rayonnant, heureux, bienveillant, aimant, accueillant, indulgent – produit spontanément en nous un effet de résonance correspondant – à moins que notre regard récepteur soit vide ou fermé, du fait de notre incapacité (passagère ou non) à entrer en résonance, ou parce que nous nouons un rapport délibérément répulsif avec le monde […][10] .»
Face à un portrait photographique, on a le temps. On a le droit de fixer un regard, de détailler un visage, d’observer le contexte autour de la personne. Habituellement, on ne peut pas faire cela, l’éducation à la politesse nous enjoint à « ne pas fixer » les gens. « Faire du portrait est une bonne excuse pour observer les gens plus longuement. C’est si simple, mais c’est une chose géniale. Pouvoir regarder le visage d’une personne, surtout s’il/elle se relaxe, qu’il ou elle peut laisser son visage être plus vulnérable », nous dit Gregory Halpern, photographe de l’Agence Magnum, « et je me sens tellement reconnaissant quand quelqu’un m’offre cela.[11] »
« Dans un magazine, il y a un certain type de beauté qu’on célèbre », continue Gregory Halpern. Mais il a toujours ressenti cela comme oppressant, car il voit la beauté chez les gens. Il est intéressé par un genre différent de beauté. Il considère que ce sont les défauts qui font la beauté des gens et qui les rendent attachant.es. Quand on regarde une photo, il y a là quelque chose auquel on peut se rattacher, parce que nous sommes tous.tes imparfait.es. On essaie de cacher ces défauts, on les cache dans les pubs et les médias sociaux. Pourtant ces défauts sont des clés de qui nous sommes, parfois bien plus que les forces qui nous font bien paraître[12]. Cela rejoint ce que le portraitiste Ivan Weiss définit comme clé de lecture d’un bon portrait : la différence entre beau et intéressant[13]. Beau, c’est le bien paraître, quant à intéressant, c’est une qualité difficile ou impossible à définir formellement, mais qui tient à ce qui nous capte dans un portrait. Cela offre une clé de lecture bien plus utile au/ à la photographe. Selon lui, un portrait est intéressant s’il touche, s’il capte votre attention, vous interroge, et cela ne tient pas forcément à la beauté du sujet.
Mais alors qu’est-ce qui serait intéressant dans le portrait d’une personne ? C’est peut-être justement l’insaisissable d’une individualité, ce qui reste mystérieux chez l’autre. David Le Breton, dans son anthropologie des visages, épingle le mot hébreu Panim : « Panim signifie “un visages”, toujours écrit au pluriel. Non pour signifier le surnombre, écrit André Bénhaïm, mais parce qu’il n’y a pas d’“unité simple” d’un visage. Plus qu’un indémontrable, Panim suggère l’incommensurable, l’insaisissable.[14] » Le soi reste une multitude toujours inconnue, toujours changeante. Insaisissable. Quant à Phillip Prodger, dans son histoire du portrait photographique, il nous dit : « La personnalité est insaisissable, et les portraits les plus réussis sont parfois aussi ambigus que les modèles qu’ils donnent à voir.[15] »
Dans un très bel échange épistolaire entre Paolo Roversi, photographe, et Emanuele Coccia, philosophe, ce dernier dit ceci : « La photographie d’une personne ne restitue pas seulement une certaine intimité, mais aussi un mystère : quelque chose qui ne t’appartient pas et ne t’appartiendra jamais, et qui précisément pour cette raison sera toujours surprenant.[16] » Roversi vient avec une approche peut-être plus essentialiste, mais plus accessible, en parlant de la vie que dégage un individu : « […] (le photographe) est aidé par ce que j’appelle l’autre lumière, celle que chacun porte en soi, tel un flambeau affirmant son existence.[17] » Une lumière intérieure donc et « par sa capacité à fixer la lumière, la photographie ajoute de la vie au monde[18] ». « Cette présence nous émeut, nous lie au sujet, nous unit. [19]»
À l’opposé de l’approche de Roversi, Alec Soth[20], photographe de l’agence Magnum, dit « qu’une photo ne montre jamais l’âme d’une personne. Une photo est une photo, une âme est une âme. C’est différent. Quand on fait un portrait, il faut se rappeler qu’on prend des surfaces externes. Donc l’appareil photo ne photographie pas l’âme. On voit les cheveux, la peau et l’expression. À partir de là, on lit et on tente d’interpréter ce qui se passe intérieurement. »
Et qu’est-ce qui se passe du côté du/ de la regardant.e ? Que se passe-t-il quand, face à une photographie, nous sommes touché.es par la personne face à nous ? Un.e inconnu.e ! Quelqu’un.e avec qui on n’a aucun lien, aucune histoire. Des mois, voire des années après avoir pris la photo, dans un autre lieu, le/la regardant.e d’une image est touché.e par le portrait, voire interpellé.e par le regard d’un.e inconnu.e photographié.e, probablement touché.e par ce mystère insaisissable mentionné juste avant. Gregory Halpern se pose les mêmes questions : « Pourquoi devrait-il/elle ressentir quelque chose ? Pourquoi devrait-il/elle porter attention à cette personne ? Dans un sens évolutionniste, on ne devrait pas porter attention à quelqu’un qu’on n’a jamais rencontré, on ne devrait pas ressentir quelque chose pour une telle personne. Pourquoi est-ce que cela arrive ? C’est un mystère. Mais vous pouvez ressentir quelque chose. C’est un peu magique et plein d’espoir pour le monde.[21] » Cela reste étrange et c’est peut-être très bien ainsi. Quelque chose passe au travers de la photographie. Quelque chose qu’un.e photographe aura perçu, mis en image pour finalement réussir à toucher quelqu’un.e d’autre ailleurs. C’est aussi cela qu’on aime en tant que regardant.e : être touché.e par ce je-ne-sais-quoi dans une image. « La photographie n’est pas seulement un langage de figures, mais principalement de sentiments, il ne s’agit pas seulement de ce qu’elle nous fait voir, mais surtout de ce qu’elle nous fait éprouver[22] », dit Roversi.
Entrer en relation
Se laisser affecter par l’autre et accepter la différence avec lui/elle, le portrait photographique pourrait être un moyen d’accepter la différence, ainsi que ce qui nous trouble quand nous sommes face à cet.te inconnu.e. La photographie nous permet de sentir qu’il y a un écart dépassable, qui permet le lien et une rencontre entre deux univers. On reconnaît en l’autre, comme en soi, cette profonde humanité qui nous lie. Un être sensiblement humain comme soi et différent en même temps. Une singularité et une humanité commune.
Pour Susan Meiselas, photographe de l’agence Magnum, il est important de considérer l’autre entièrement et humainement : « En tant que photographe, je refuse de voir les gens comme des objets. Je veux trouver d’autres points de départ pour photographier, qui permettent d’instaurer une relation. Ou du moins, essayent de nouer une relation. Et un jour, nouer une relation différente, non seulement, avec la personne photographiée ou le sujet, mais aussi le public ou la personne qui n’est pas sur la photo, et qui regarde la photo.[23] » Selon moi, la photographie serait un art de la relation au monde, aux lieux mais aussi aux êtres qui les habitent. Sur ce point, Gregory Halpern dit : « Il y a une relation brève mais intense qui peut se créer avec le sujet, c’est un peu comme tomber brièvement amoureux de quelqu’un, le temps de l’interaction.[24] » Et Paolo Roversi complète en disant : « Photographier exige un effort important pour entrer en lien avec un autre être, avec quelque chose d’extérieur à soi, qui se trouve face à soi. Photographier, c’est chercher ce contact simple mais direct et profond.[25] »
Et si nous prenons le « faire relation » comme un acte d’hospitalité, alors peut-être pouvons-nous dire que le portrait photographique favorise l’hospitalité. Et si nous revenons du côté du/ de la regardant.e et de la relation qu’il/elle instaure avec le/la portraituré.e, on peut sans doute en tirer la même conclusion. Mais terminons avec les mots de la portraitiste Judith Joy Ross : « Si on perçoit ce qu’il y a de beau chez une personne, on va nouer automatiquement un lien avec elle. Si on se lie avec elle, on va se sentir concerné, et si on se sent concerné, on devient responsable. Alors oui, c’est évidemment facile d’avoir un point de vue détaché sur les autres. Moi je demande la possibilité de concentrer notre attention sur toutes les raisons qui nous les rendent précieux. Toutes les raisons qui nous les rendent uniques.[26] »
Notes
[1] « New Topographics : Photographs of a Man-Altered Landscape » (« Nouvelles topographies : Photographies du paysage modifié par l’homme ») est une exposition photographique organisée en 1975 (…) Elle a représenté un tournant dans l’évolution de la photographie documentaire et dans la représentation des paysages urbains contemporains. On y retrouvait des noms comme Stephen Shore, Lewis Baltz, Robert Adams, Bernd et Hilla Becher, etc. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Topographics ou encore https://www.photophiles.com/index.php/evenements/1466-new-topographics
[2] Lire « Se préparer à des gestes d’hospitalité », Olivier Croufer, 2018.
[3] Lire « De l’éthique individuelle à la pratique collective : la question de l’institution », Mathieu Bietlot, 2018.
[4] « On photographing people and communities », Dawoud Bey, Aperture, 2019, p. 60.
[5] Citation de Lionel Trilling à propos du livre « Let Us Now Praise Famous Men », collaboration entre Walker Evans et James Agee sur les fermiers de l’Alabama. Cet extrait est tiré du livre « Le style documentaire. D’August Sander à Walker Evans. 1920-1945 », Olivier Lugon, Macula, 2001, p. 162-163.
[6] Dawoud Bey, ibid.
[7] Citation de Lincoln Kirstein à propos de Walker Evans (dans la postface de « American Photographs », 1938. Extrait tiré du livre « Le style documentaire. D’August Sander à Walker Evans. 1920-1945 », Olivier Lugon, Macula, 2001, p. 162.
[8] Enquête réalisée auprès du groupe d’arpentages photographiques du Centre Franco Basaglia, le vendredi 25 avril 2025. Ce groupe était constitué ce jour-là de Louise W, Sébastien B, Fabrice B, Fabrice W, Richard F et Pascale W.
[9] Lors de la discussion, les portraits réalisés par Robert Bergman avaient marqué : https://www.therobertbergmanarchive.org/photo-color-portraits.html
[10] « Résonance », Hartmut Rosa, 2018, éd. La Découverte, p. 81.
[11] Gregory Halpern, issu de la vidéo « People », dans la formation « Documentary Sur/Realism », agence Magnum.
[12] Gregory Halpern, ibid.
[13] « Portraiture Photography | Ivan Weiss », publié par Dogma85, le 23 octobre 2023 : https://youtu.be/Mx79M6c1Hso?si=lMS67UwrAA4kCXSc
[14] Benhaïm, « Panim. Visages de Proust », 2006 ; cité par David Le Breton in « Des visages. Une anthropologie. » – David Le Breton, Métaillé, 2022, p. 25-26.
[15] « Une histoire du portrait en photographie », Phillip Prodger, éditions Alter Ego, 2021, p. 13.
[16] Roversi et Coccia, p. 64-65.
[17] « Lettres sur la lumière », Paolo Roversi et Emanuele Coccia, éditions Gallimard, 2024, p. 33.
[18] Roversi et Coccia, ibid., p. 43.
[19] Roversi et Coccia, ibid., p. 82.
[20] Alec Soth – « À propos des personnes », dans la formation « Alec Soth : photographic storytelling », agence Magnum.
[21] Gregory Halpern, ibid.
[22] Roversi et Coccia, ibid., p. 99-100.
[23] Susan Meiselas, dans la vidéo « Nouer des relations », de la formation « The art of street photography », agence Magnum.
[24] Gregory Halpern, ibid.
[25] Roversi et Coccia, ibid.
[26] Judith Joy Ross, in « Photographies 1978-2015 », Atelier EXB, 2022, p. 30.