C’est pas grave !
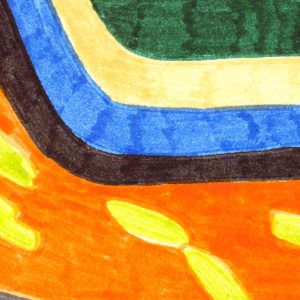
Auteur : Christian Legrève, animateur au Centre Franco Basaglia
Résumé : Dans La société du mépris, publié aux éditions la découverte en 2006, le philosophe Axel Honneth aborde la question de l’invisibilité ou de la non-existence sociale en montrant que l’invisibilité passe bien par une opération de mise en visibilité préalable. Celle-ci consiste à identifier l’autre que l’on ne souhaite pas voir. Le mépris se manifeste dès lors que l’on agit envers l’autre en faisant comme s’il n’était pas là, ce qui suppose bien une identification préliminaire afin de ne pas le voir ou de donner l’impression de «voir à travers lui».
Temps de lecture : 15 minutes
Mercredi 25 juillet. 10h30. Je sors de l’agence Fortis en Feronstrée. Je récupère mon vélo, attaché à un poteau de signalisation.
Elle est devant l’entrée de la supérette. Elle s’avance, en tendant la main pour me saluer. 25 ans environ. Très enveloppée. Débardeur noir et pantalon de Jogging. Peau très pâle. Cheveux bouclés noirs rabattus vers l’arrière.
Elle reste la main tendue. Elle transpire fortement. Elle a des yeux foncés tout ronds, un regard un peu perdu, qui fuit. On a l’impression qu’elle tangue en permanence. Que son corps, son esprit peut-être, est sans cesse balloté, agité par une houle.
— On se connaît… De l’atelier.
— Oui, oui, bien sûr (mon œil, faux cul !). mais je ne sais plus comment tu t’appelles.
— Corinne.
— Ah oui ! (c’est ça !)
Je suis (gentil) animateur. J’avais effectivement rencontré Corinne à l’occasion d’une (gentille) animation à l’atelier artistique qu’elle fréquente, avec d’autres personnes en souffrance psychique.
— J’ai pas mangé
— …
— J’ai mal à la tête
…
Il me faudrait des corn flakes. Et du lait.
J’ai fait la manche, mais ça ne marche pas.
Je vais être clair. Face à la mendicité, et même si je sais que ça mérite discussion, j’ai pris le parti de ne jamais donner de sous. Je ne vais pas développer ici les raisons de ce choix, ce n’est pas le sujet. Ce que je voudrais analyser, c’est ce qui change dans cette situation particulière.
Pour Corinne, ça me paraît clair. Elle s’en sert pour établir le contact. Pas seulement parce qu’elle me connaît, mais aussi parce que nous avons été dans une situation où j’essayais de créer une relation. J’ai été gentil avec elle. Elle suppose qu’elle peut en tirer bénéfice. Elle est fondée à penser que je suis un type qui donne des sous aux gens qui en ont besoin.
Chez moi, ça provoque des réactions très contradictoires. Je dirais même un enchâssement de contradictions qui donne le tournis. Qui ne peut que conduire à l’impossibilité d’une action.
Je sais qu’elle est atteinte d’un trouble mental. Ça me fait considérer autrement ce qui se passe entre nous. Je la vois différemment. Je suis touché autrement par sa détresse. Je vais tenter une introspection pour comprendre, et je te demande, lecteur, lectrice, de ne pas me juger durement. Je fais l’hypothèse que cet exercice peut t’être utile à toi, parce qu’il révèle des zones d’ombre qui ne me sont pas propres.
Alors, qu’est-ce que ça change, que Corinne soit estampillée malade mentale ? Je dirais que c’est comme si sa détresse sociale était plus légitime, ou plus susceptible d’être prise en compte parce qu’elle est sanctionnée (du moins je le suppose) par un diagnostic. C’est une personne malade. Elle échappe totalement au soupçon qu’elle serait responsable de sa situation. Et aussi, cet état ne serait pas inéluctable. « Pour certains, la pauvreté elle-même est une maladie. Ça permet de ne pas remettre en question le problème économique qui est à la base de la pauvreté. Il suffit donc de soigner pour supprimer la pauvreté. C’est tout le problème de la psychiatrisation de la pauvreté »[1].
D’autre part, je suis tenu de quitter mon attitude habituelle face à quelqu’un qui fait la manche. Je ne peux pas afficher cette empathie de commande que je manifeste dans ces cas-là : Je regarde la personne, je lui souris (d’un air désolé du plus mauvais effet), et je lui indique poliment (et fermement ?) que je ne lui donnerai rien. Mais j’ai compris, en croisant Corinne ce jour-là, que cette attitude entretient la distance, la manifeste violemment, et je comprends mieux certaines colères qu’elle a pu provoquer. Ici, pas possible, je connais Corinne. J’ai échangé avec elle. Je ne peux pas faire semblant. Je laisse tomber la barrière habituelle, et je ne dissimule pas le malaise que provoque la situation.
À l’inverse, je m’aperçois en y repensant, il m’est venu en tête quelque chose comme « c’est une relation professionnelle. Je dois maintenir une distance qui permette de ne pas compromettre la suite de cette relation ». Ce n’était pas complètement conscient, sur le moment. C’est très bizarre, parce que je ne suis pas le soignant de Corinne, ni son thérapeute ou son analyste. Je n’ai aucune raison de préserver une qualité de relation d’aide particulière, ni «[ ] à la manière d’une mère tendre, qui n’ira pas se coucher le soir avant d’avoir discuté à fond, avec son enfant, et réglé, dans un sens d’apaisement, tous les soucis grands et petits, peurs, intentions hostiles et problèmes de conscience restés en suspens[2] », ni d’une autre manière. C’est une réaction complètement stéréotypée qui m’est venue en tête. Et c’est une excuse, je pense, encore une barrière. Vis-à-vis d’elle, bien sûr, mais aussi pour garder à distance mon propre malaise.
Mais aussi, je suis sur mes gardes. Je me méfie de sa réaction. Je ne me sens pas en danger, mais je crains un débordement émotionnel, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que crains, en fait. Quelque chose que je ne connais pas. Une réaction qui risque de me dépasser et de me mettre en difficulté.
Et puis, en fait, pas du tout.
— … Tu sais, je ne vais pas te donner d’argent.
— C’est pas grave !
— Tu n’as pas mangé aujourd’hui ?
— Non ! pas encore.
— …
— …
— Fais attention à toi. Bon courage !
D’habitude, face à la mendicité, je n’ai pas de fausse honte. Je me sens en accord avec mon attitude. Avec les réserves que j’ai évoquées. Mais ici, je ne suis pas trop content de moi. D’autant plus avec sa curieuse réponse à mon refus, affirmée avec une certaine emphase. : « C’est pas graaave ! ». Dans l’énergie qu’elle y a mis, j’ai entendu « Tu n’es pas le premier à me dire non. Et pas le dernier, probablement. Ça ne m’étonne pas (de toi, de moi). Et ça ne changera rien à ma situation ». Bien entendu, je ne prétends pas que c’est ce que Corinne veut dire. C’est dans ma tête à moi que ça survient.
Et ça résonne soudain avec un autre « C’est pas grave”, qui m’avait tout autant étonné. C’était à la gare des Guillemins, le 6 avril en début de matinée.
Elle m’accoste à la sortie piétonne du parking. Elle a un physique de beauté fatiguée, je dirais. Elle est rousse, et habillée de manière assez voyante. J’ai noté qu’elle portait une casquette de cuir, garnie de clous argentés. Elle me raconte, tout à trac, qu’elle a 56 ans ce jour-là et que son mari s’est pendu quelques mois auparavant. Elle m’explique aussi quelque chose que je ne comprends pas au sujet de son poignet. Où elle est blessée, je suppose. Elle est en grande difficulté, parce qu’elle n’est pas « reconnue comme SDF ». Elle vient de Seraing, où elle se plaint que l’abri de nuit « vous met à la porte » à 6h du matin, jusque 21h. Et sa carte de bus est remplie.
Ici aussi, j’ai écouté jusqu’au bout en la regardant. Puis, je lui ai dit que je ne lui donnerais rien.
« C’est pas grave ! ». Sur le même ton que Corinne, l’autre matin. Exactement.
Edouard Delruelle confirme : « Que la perte de dignité soit fonction de la condition d’inutile, de superflu, cela est évident dans le cas des chômeurs, des exclus, ou des malades et des handicapés, ou encore dans celui des détenus. Situations fort différentes les unes des autres, certes, mais dont le « résultat » est à chaque fois que l’individu se retrouve dans une position de surnuméraire, d’homme qui à la fois est « sans » (sans travail ou sans capacité de travail, sans liberté, sans sécurité juridique) et « en trop » pour la communauté » [3].
Et moi, bien sûr, non surnuméraire, utile à la communauté, humaniste qui se voit comme appartenant à la classe moyenne, je me suis fait un devoir de traiter dignement les gens qui mendient. De les « accueillir » avec humanité, en les regardant droit dans les yeux, en leur parlant comme à n’importe qui d’autre, en reconnaissant mon incapacité individuelle à changer leur situation individuelle et collective.
Mais Edouard Delruelle ne me laisse pas une chance : « En rappelant de façon incantatoire que les exclus, les malades, les vieux, les pauvres, etc., bref tous les surnuméraires de notre société, doivent garder leur dignité, qu’il est un devoir de les traiter comme des êtres dignes, en ressassant ce discours, que fait-on, sinon jeter un voile éthico-juridique pudique sur le système économico-politique qui produit massivement de tels individus ? » [4]
Et ça, c’est grave !
Références
[1] Luttes solidarités travail ; La dignité, parlons-en ; 2003
[2] Ferenczi ; Analyse d’enfant avec des adultes (1931), Psychanalyse IV, Payot, 1982
[3] Edouard Delruelle ; dignes de mourir comme inutile au monde ; in Pauvreté – dignité – droits de l’homme, Les 10 ans de l’accord de coopération ; centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale ; décembre 2008
[4] ibid

