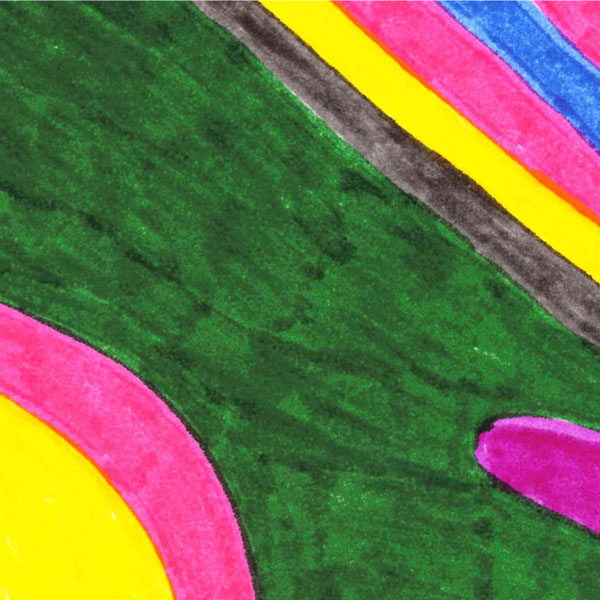Maladie mentale et responsabilité, le dilemme du juge Bertrand
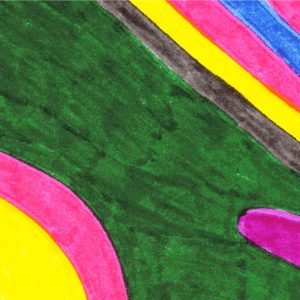
Auteur : Christian Legrève, animateur au Centre Franco Basaglia
Résumé : Le juge Bertrand achetait son journal sur le trajet depuis le palais de justice, mais, aujourd’hui, à la vérité, il savait très bien qu’il ne le lirait pas. Il avait à réfléchir. L’affaire de ce matin le perturbait.
Temps de lecture : 15 minutes
— Alors, aujourd’hui, on a… minestrone, grosses pâtes, tagliatelles, spaghetti, roastbeef, rôti de porc, des escalopes panées, salade, tomates, trevise, fèves en salade, haricots plats.
Le juge Bertrand adorait ce moment. Marianna débitait toujours le menu, presque immuable, d’une seule traite, le regard au loin, l’air vaguement agacé. Il venait toujours après l’audience du matin, le mercredi. Le jour des escalopes. Il prenait toujours l’escalope. Mais il feignait à chaque fois d’hésiter, de réfléchir.
— Mmmmh… Grosses pâtes à la tomate…, escalope, fèves en salade.
— D’accord (elle insistait et traînait toujours sur la première syllabe. Un soupçon de moquerie ? Peut-être pas, en fait). Et pour boire ? Une eau gazeuse et un quart de vin rouge ?
— C’est ça, oui…
Elle disparut dans la petite cuisine emfumée pour répéter la commande en patois du Frioul, de sa voix un peu lasse, en commençant, comme toujours par « Allora… ».
La petite salle bruissait, comme toujours, des conversations à mi-voix et des bruits de couverts. Bertrand était à sa place habituelle, dans la deuxième pièce, qui donnait directement sur la cuisine. La mère passait régulièrement la tête dans l’ouverture pour voir qui était là et saluer, du menton, les habitués. C’est-à-dire à peu près tout le monde. Bertrand s’asseyait toujours à la première table à gauche sous le tableau naïf représentant des immigrés italiens arrivant dans le port de New-York sur un bateau de papier, réalisé avec un journal plié : « l’Emigrante ».
Il achetait, lui, son journal sur le trajet depuis le palais de justice, mais, aujourd’hui, à la vérité, il savait très bien qu’il ne le lirait pas. Il avait à réfléchir. L’affaire de ce matin le perturbait. Son assurance habituelle, sa calme confiance dans sa connaissance du droit, sa légendaire bonhommie ; tout ce qui fondait son autorité, et qu’il entretenait si jalousement, était troublé. Le pire étant qu’il ne comprenait pas bien ce qui le troublait.
Au cours de ses années au tribunal, il avait déjà été embarrassé par des affaires. Mais, en prenant du recul, il pouvait généralement identifier ce qui contrariait la bonne conduite de son raisonnement. Tel prévenu, qui lui rappelait un proche, un souvenir enchanté ou malheureux dans sa propre histoire. Tel détail saugrenu ou burlesque dans les faits. Telle avocate, qui… Il ne lui était pas longtemps difficile de faire la part des choses, et de revenir au jugement droit. Ce jeu de mot, qu’il gardait pour lui, l’amusait beaucoup.
Il éprouvait un sentiment bizarre. Il ne savait quoi penser. Ce gros homme, transpirant dans sa chemise rose, avait le regard inquiet de tous les prévenus. Mais il avait aussi un air de victime, un air doucereux. Et cette voix, cette articulation ! Traînante, grasseyante… Elle avait quelque chose d’obscène. On sentait qu’il essayait de faire bonne impression, mais quelque chose n’allait pas. Il était vaguement désagréable, obséquieux. Trop rond, finalement. Rond d’aspect, insaisissable.
Il ne contestait pas les faits. Il contestait leur interprétation. Et la charge retenue contre lui. Il jouait sur son état particulier, sur sa maladie mentale. Il n’avait pas un dossier très consistant de ce côté-là, malgré les séjours en hôpital psychiatrique. Dans ses déclarations à son avocat, il ne se prétendait pas irresponsable de ses actes, mais incapable d’appréhender leur gravité. Il avait multiplié les attestations de fréquentation de services d’accueil psychiatrique. Des ateliers, des centres de jour, des groupes thérapeutiques … tout ça ne pesait pas lourd dans son dossier. Par-dessus tout, il s’estimait aussi irresponsable que la victime, une jeune fille déficiente mentale.
Pour Bertrand, un prévenu était un prévenu, une victime, une victime, un accusé un accusé, et un coupable un coupable. Et ces catégories ne souffraient pas d’approximation. C’était là l’honneur de la justice. Il savait pertinemment que cette belle machinerie ne reposait pas sur des textes parfaitement univoques, mais aussi sur le jugement sûr de magistrats comme lui, non pas infaillibles, mais capables de reconnaître leurs propres failles, leur part d’ombre. Et de les tenir à distance.
Au passage, Marianna déposa devant lui la petite carafe de vin de table, la bouteille d’eau gazeuse et les deux verres.
— Vooooilà !
Elle poursuivit aussitôt son chemin vers la cuisine, de sa démarche caractéristique, comme si elle glissait rapidement sur le carrelage mille fois parcouru. Comme si elle patinait. Depuis le décès de Dario, plus personne ne s’arrêtait au bar pour prendre ses boissons avant de rejoindre sa table, et Marianna faisait tout le service toute seule, avec diligence, et, apparemment, avec la plus grande aisance.
Le prévenu avait eu des relations sexuelles avec cette jeune fille. Certaines personnes pourraient considérer le dommage subi comme relatif. Il semblait établi, en tous cas, qu’il n’y avait pas eu violence. Les faits se sont d’ailleurs répétés plusieurs fois dans le cadre d’une relation suivie. Ce n’est pas la victime qui avait déposé plainte, mais son entourage.
Bertrand essayait de revenir à la loi. La qualification d’attentat à la pudeur ne nécessite plus de menaces ou de violences, mais les textes ne le définissent pas précisément[1]. Il faut qu’il y ait « une atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne sans le consentement de cette dernière ». Le viol, par contre, la forme la plus grave d’abus sexuel, est constitué sur base de deux éléments. Selon l’article 375 du code pénal, il faut qu’il ait pénétration sexuelle (que ce soit avec le pénis, les doigts ou encore un objet) et absence de consentement de la victime.
Or, dans certains cas, la loi présume que la victime n’est pas en mesure de consentir, et c’est notamment le cas si le viol « a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime ».
La loi considère, par principe, qu’une personne qui souffre d’une déficience mentale n’est pas en mesure de donner son consentement. Il n’y a pas d’échelle, de mesure, d’appréciation de ce principe. La jeune fille ne pouvait être tenue pour responsable d’elle-même. Il y avait donc délit, c’était peu contestable.
Par contre, la responsabilité d’une personne qui souffre de troubles psychiques fait l’objet d’une appréciation. Qui aura pour conséquence, soit une peine de prison, soit un enfermement dans un établissement de défense sociale. Le cas échéant, on aura recours à un expert psychiatrique pour déterminer si, au moment des faits, le prévenu était responsable de ses actes. Au moment des faits. La loi reconnaît le caractère foncièrement variable des troubles psychiques, et de leurs conséquences sur la vie des personnes. Comment les experts s’arrangent pour répondre à la question était un autre problème …[2]
C’est bien la question de la responsabilité de chacune des deux personnes sur ses propres actes qui était en question.
Quelque chose clochait. Est-ce que les troubles psychiques du prévenu pouvaient être mis sur le même plan que la déficience mentale de la victime ? Non pas en termes de gravité, mais en ce qui concerne le rapport aux actes, la responsabilité de soi ?[3]
Marianna revenait avec les assiettes. « L’escalope, grosses pâtes à la tomate, et les fèves en salade. Bon appétit ! »
Bertrand ne pouvait pas estimer que le prévenu était irresponsable. Il n’avait pas besoin d’un expert pour ça. Par contre, il n’était pas facile d’établir le risque qu’il commette à nouveau les mêmes faits, et constitue, par là, un danger pour la société. Quand bien même, un enfermement en défense sociale serait, dans le cas du gros bonhomme, bien plus dommageable pour lui qu’utile, en quoi que ce soit, pour qui que ce soit[4].
Mais le personnage était dérangeant. Il y avait quelque chose, dans son attitude, qui dissuadait de prendre en compte simplement ses actes pour les qualifier. Quelque chose faisait écran, créait un flou. On avait du mal à faire la mise au point. À le fixer.
Ce type était exaspérant ! Sa manière de se réfugier derrière son état avait quelque chose de pitoyable, et d’indigne. Il était prêt à renoncer à sa condition d’homme parmi les hommes pour échapper à ses responsabilités. Bertrand se rendait compte que ça le touchait au plus profond. Comme si c’était son humanité à lui qui était mise en question.
Il mâchonnait longuement son escalope sans arriver à avaler. Ça ne passait pas ! On est responsable ou pas… Il peut y avoir un doute, ou une question, des investigations à poursuivre, des éléments nouveaux à rechercher. Mais il ne pouvait subsister de zone grise. On ne pouvait pas aboutir à une demi-mesure, rester sur une indécision. L’expression, c’est « décision de justice », nom de dieu !
Cette histoire le minait. Ça faisait des jours qu’il y pensait. Il lui arrivait de se réveiller au bout de la nuit, juste avant le point du jour, avec le souvenir d’un rêve désagréable qu’il n’arrivait pourtant pas à se remémorer précisément. Il se souvenait juste du sentiment déplaisant d’une présence embarrassante, envahissante, poisseuse. Et à chaque fois, l’image du gros bonhomme lui revenait juste après.
Nom de dieu ! Quelle horreur ! Vous avez déjà eu en bouche de la viande avariée ? Vous voyez, ce goût qui fait penser au cadavre, à la putréfaction en marche. Cette escalope était absolument dégueulasse ! Immangeable. Pourrie, pour tout dire. Et il mastiquait ça depuis dix minutes, sans s’en rendre compte. Cette impression horrible ! Ce haut-le-cœur !
Et tout à coup, il s’est souvenu ! Cette sensation insupportable de manger un cadavre, il l’a déjà ressentie. Il y a très longtemps.
Bertrand était fils unique, et avait été un enfant calme, un peu secret, impressionnable. Il avait logé un jour chez son oncle et sa tante, qui n’avaient pas d’enfant. C’était tout à fait exceptionnel, et il avait le vague souvenir de l’avoir vécu comme un abandon par ses parents. Il connaissait peu l’oncle et la tante, et ne les aimait pas beaucoup. La maison, sombre, isolée, pleine de recoins et de pièces inutilisées l’effrayait un peu. Dans la lumière finissante de l’après-midi, il était resté seul un long moment avec l’oncle Jean, qui s’était mis à lui raconter avec insistance des histoires abracadabrantes sur les esprits qui rôdaient dans la maison, qui lui parlaient, et qui voulaient l’emmener dans l’au-delà. L’enfant se sentait coincé et ne savait pas comment réagir. La tante était sortie de la cuisine en furie, en sueur, les cheveux ébouriffés, en rabrouant son mari. « Ne fais pas attention, gamin ! Il perd la boule. Ça lui arrive encore bien !». Le malaise avait toutefois perduré. La soirée avait été sinistre, le petit ayant eu l’impression pendant tout le repas que les choses avaient un drôle de goût. Il ne pouvait s’empêcher de penser qu’on essayait de l’empoisonner.
Plus tard, ses parents lui avaient expliqué avec beaucoup de douceur qu’effectivement, l’oncle Jean avait quelque chose qui ne tournait pas rond. « Il ne faut prendre trop au sérieux tout ce qu’il raconte et, surtout, il ne faut pas lui en vouloir. Il n’en peut rien, il n’est pas responsable ! ». Longtemps, le petit était resté perturbé par cet évènement. Ils n’en avaient plus parlé, mais jamais plus il n’était allé là-bas.
Cette histoire, qu’il avait oubliée, lui revenait tout à coup. Son prévenu du matin lui rappelait l’oncle Jean de manière saisissante : même regard insistant, même épaisse chevelure grasse rabattue en arrière, même peau luisante, même ventre proéminant. Même air doucereux. Dans son souvenir, en tous cas.
Le juge Bertrand crachait dans sa serviette les restes de viande. Il buvait de grands verres d’eau que Marianna apportait, épouvantée. Ça n’arrivait jamais ! Elle ne comprenait pas ! Elle n’avait jamais été aussi volubile. C’était l’évènement dans le petit restaurant. On entendait, dans la cuisine, la mère vociférant en Frioulan, au téléphone avec le boucher. Mais l’horrible goût ne disparaissait pas. Il avait l’impression qu’il allait le garder toute sa vie.
Après toute cette agitation, il était sorti prendre l’air pour tenter de retrouver son calme. Heureusement, il n’avait pas d’audience, et avait pu annuler ses rendez-vous de l’après-midi. Il avait marché au hasard. Il avait franchi les ponts, remontant et redescendant plusieurs fois les rives du fleuve. Il ressentait une immense lassitude, et une sorte de dégoût qui touchait toute sa vie. Il rendait des ordonnances au nom de grands principes, dans un langage policé, sur base de raisonnements savamment construits, bouffi dans sa bonne conscience et son sens des responsabilités. Mais quel était le sens de tout ça ? Qu’est-ce que ça cachait ? Il était lui-même étonné de ce que cette affaire venait remuer en lui.
Il se sentait totalement incapable de porter un jugement rationnel sur la responsabilité de ce type qui lui faisait, en même temps, horreur et pitié. Il était même hors de question qu’il puisse le rencontrer à nouveau. L’idée seule faisait remonter la nausée.
Références
[1] Article 372 du code pénal
[2] Sur la conciliation des fondements du droit pénal et de la clinique psychiatrique, lire Jean-Louis Senon ; troubles psychiques et réponses pénales ; congrès français de criminologie ; 2008. https://journals.openedition.org/champpenal/77?lang=en
[3] Sur l’histoire philosophique de cette question, lire Marc Anglaret ; maladie mentale et responsabilité. http://philo.pourtous.free.fr/Articles/Marc/maladie_mentale.htm
[4] Pour une analyse du dispositif de défense sociale en Belgique, on pourra lire Marie Absil ; L’irresponsabilité pénale, une injonction paradoxale ; CFB ; 2016.