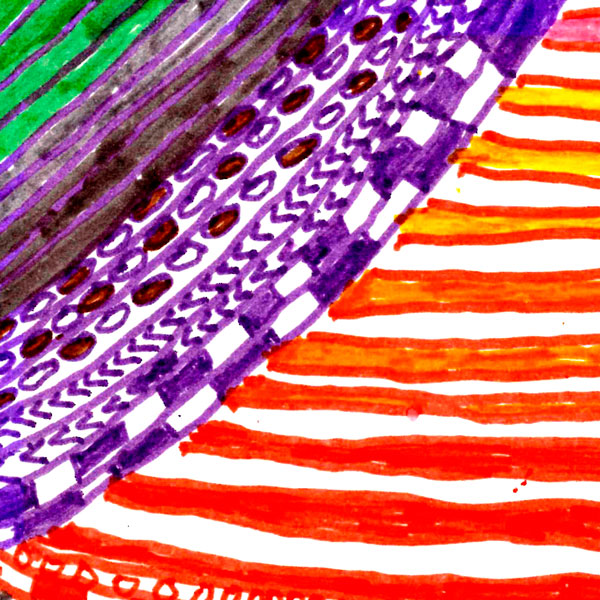Gros-Câlin, histoire(s) de mue(s)
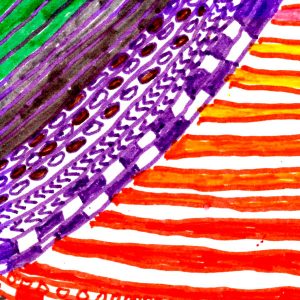
Auteur : Catherine Thieron, animatrice au Centre Franco Basaglia
Résumé : Récit drôle et touchant de la solitude ordinaire où le trouble est omniprésent, le premier roman d’Émile Ajar (en réalité le vingtième de Romain Gary) nous met dans la peau de Michel Cousin, statisticien parisien esseulé et peu sociable, dont les besoins affectifs sont comblés par un python de deux mètres vingt – le bien-nommé « Gros-Câlin ».
Temps de lecture : 15 minutes
En 1974, Romain Gary est un auteur populaire, connu et reconnu : lauréat du prestigieux prix Goncourt en 1956 pour « Les Racines du ciel », il publie un à deux livres par an – et en écrit bien davantage. La rédaction du roman « Gros-Câlin » marquera la naissance d’un nouveau venu dans le petit monde de l’édition : un certain Émile Ajar. Bien que personne ne sache rien de lui (et certainement pas le fait que Gary se cache derrière ce pseudonyme), « Gros-Câlin » est un succès critique et commercial et marquera le début du plus grand canular de l’histoire de la littérature.
C’est un homme avec personne dedans [1]
Statisticien parisien esseulé et peu sociable, Michel Cousin est secrètement amoureux de sa collègue de travail, Mlle Dreyfus, et se fait des tas de films quand ils partagent l’ascenseur, interprétant les rares paroles que la jolie Guyanaise daigne échanger avec lui comme autant de confirmations que cet amour est partagé. En attendant le mariage tant espéré, il se console auprès de Gros-Câlin, python de deux mètres vingt qui lui assure un réconfort transitoire en le serrant chaque soir dans son unique bras très froid. L’étreinte du reptile apporte à notre anti-héros un apaisement éphémère, lui qui a tant besoin d’être aimé. Au point où il en est, ma foi, un python, c’est toujours mieux que rien.
Parce que Michel Cousin est profondément seul… et tout à fait incapable de reconnaitre à quel point cette solitude lui pèse. Produit de son époque, il scrute, dissèque et analyse systématiquement la société qui l’entoure avec un détachement quasi-scientifique, et ses rares sursauts d’émotions sont autant d’éléments perturbateurs dans sa vie bien rangée – et néanmoins hors normes puisque, malgré son inaptitude à créer du lien social, sa vie intérieure est riche et foisonnante, et sa vision du monde tout à fait singulière :
« La vérité est que je souffre de magma, de salle d’attente, et cela se traduit par un goût nostalgique pour divers objets de première nécessité, extincteurs rouge incendie, échelles, aspirateurs, clés universelles, tire-bouchons et rayons de soleil. Ce sont là des sous-produits de mon état latent de film non développé d’ailleurs sous-exposé. Vous remarquerez aussi l’absence de flèches directionnelles. »[2]
En l’absence de flèches directionnelles – comme de contacts humains épanouissants –, Cousin rêve d’un monde meilleur en personnifiant les objets (et son animal de compagnie), et peu d’humains qui l’entourent sont de véritables personnes à ses yeux ; tout au plus sont-ils des prologues à l’Humanité (qu’il qualifie de « prologomènes », soit « prologues aux men »). D’ailleurs, il reconnaît volontiers être lui aussi absent de lui-même :
« Il ne me reste plus, pour faire le pas décisif, qu’à surmonter cet état d’absence de moi-même que je continue à éprouver. La sensation de ne pas être vraiment là. Plus exactement d’être une sorte de « prologomène ». Ce mot s’applique exactement à mon état, dans « prologomène » il y a prologue à quelque chose ou à quelqu’un ; ça donne de l’espoir. Ce sont des états d’esquisse, de nature très pénible, et lorsqu’ils s’emparent de moi, je me mets à courir en rond dans mon deux pièces à la recherche d’une sortie, ce qui est d’autant plus affolant que les portes ne vous aident pas du tout. »
Lorsqu’il est aux prises avec ses questions existentielles – génératrices d’autant d’angoisses –, seule l’intense étreinte de Gros-Câlin est à même de lui apporter du réconfort.
« Comme un costume qu’on revêt ou enlève selon les besoins de la scène, le python répond à une nécessité impérieuse, celle d’éviter la rencontre authentique avec « l’autre ». (…) Gros-Câlin, c’est plus que le signe d’une présence, c’est un élément indissociable de Michel Cousin, un double narcissique. Cousin se confond avec son python (…) Il n’y a pas de véritable relation d’objet chez le narcissique : il n’aime pas, il se laisse aimer. »[3]
Ainsi donc, l’amour, pour Michel Cousin, se résume-t-il à la présence d’un python de deux mètres vingt qui lui apporte ce qu’il est incapable de se donner à lui-même, à l’instar des sentiments qu’il éprouve à l’égard de Mlle Dreyfus, qui ne sont en définitive rien de plus qu’un fantasme, une projection.
Beaucoup de gens se sentent mal dans leur peau, parce que ce n’est pas la leur
L’expérience de la solitude du personnage est similaire à celle de beaucoup de citadins, sa difficulté à entrer en lien faisant écho à celle qu’éprouvent bon nombre d’individus. Par moments, il nage en plein délire paranoïaque, notamment dans sa certitude quasi-inébranlable que Mlle Dreyfus l’aime en retour ou que Gros-Câlin s’enroule autour de lui par affection. À propos de la relation qu’il entretient avec ce dernier, il dit : « Je ne veux pas être ajusté à l’environnement, je veux que l’environnement soit ajusté à nous. »[4], une phrase qui prend tout son sens dans l’expérience du trouble psychique dont le narrateur semble n’être pas exempt.
Et pourtant, à aucun moment Romain Gary/Émile Ajar n’invite à la pitié : au contraire, chaque action de Michel Cousin semble appropriée eu égard à ses monologues internes profondément radicaux et cependant teintés d’espoir et de pensée magique. On en vient même à se demander si, par son refus de jouer le grand jeu social (et ce, malgré son respect exacerbé de l’autorité), il n’est pas, dans le fond, le seul être sensé dans cette histoire.
« Dans leurs habits sociaux, les hommes ne parviennent pas à de véritables discours humains. Cousin sait tout cela et attend que les hommes abandonnent le Grand Vestiaire des majorités. (…) Pour Cousin, la vie en société n’en est plus une. (…) il oppose au monde sa singularité et laisse ainsi une porte entrouverte à tous les possibles. »[5]
En observant Gros-Câlin et ses mues successives, le narrateur se prend à rêver d’une mue sociale, d’une métamorphose en profondeur du monde qui l’entoure et qu’il peine à habiter. Hélas, le serpent qui lui sert de compagnon de vie est bien décevant, car fondamentalement, il ne change pas plus que les gens et la société :
« Les pythons sont à titre définitif. Ils muent, mais ils recommencent toujours. Ils ont été programmés comme ça. Ils font peau neuve, mais ils reviennent au même, un peu plus frais, c’est tout. Il faudrait les perforer autrement, les programmer sans aucun rapport, mais le mieux, c’est que ce soit quelqu’un d’autre qui programme quelqu’un d’autre, avec effet de surprise, pour que ça réussisse. »
Changer de peau et d’identité est une idée fixe chez Romain Gary. Écrivain multiple, homme aux mille vies, il écrit en français et en anglais alors qu’aucune de ces deux langues n’est sa langue maternelle : né Roman Kacew dans l’Empire russe en 1914, il s’amuse à donner des versions diverses, variées et souvent contradictoires de ses origines. Dans son dernier ouvrage, « Vie et mort d’Émile Ajar », publié à titre posthume en 1981, il écrit : « Je me suis toujours été un autre. »
C’est peut-être la phrase qui le résume le mieux.
En 1978, il dit au micro de Jacques Chancel : « Je n’ai aucun problème d’identité (…) [L]e caméléon (…) devient rouge quand on le met sur le rouge, bleu quand on le met sur le bleu, vert quand on le met sur le vert, etc. Et puis, on le met sur un tapis écossais, et le caméléon devient fou. Moi, je ne suis pas devenu fou, je suis devenu écrivain. Je crois que c’est ce qui m’a sauvé et a assuré ma stabilité psychique. (…) L’art et le goût de raconter les histoires est une forme de naïveté, c’est la survivance de l’enfant en nous, quel que soit le vêtement intellectuel et philosophique qu’il porte. »[6]
Une langue tout autre et sans précédent
« L’expérience de l’écriture ajarienne est à la fois celle de la solitude et celle du trop plein. En projetant sur ses personnages, ses propres souffrances, les mots instaurent la distanciation, celle qui permet d’adoucir la souffrance. Chaque personnage d’Ajar fait l’apprentissage de la solitude. Chez Ajar, la vie doit être embrassée passionnément et être palpable. C’est la raison pour laquelle ses personnages sont vivants, animés de la fureur de vivre. Or la vie est un mouvement, une dynamique portée par l’illusion. »[7]
L’alter ego de Romain Gary semble être pour lui une manière de dompter la mort, et il écrit en 1976 : « L’humanité m’a donné sa souffrance et je lui ai donné en échange un livre. »[8] En effet, ses fêlures et blessures narcissiques, l’auteur les sublime dans ses ouvrages, au même titre que l’image d’une mère omniprésente qui a généré chez lui un besoin de séduction absolu. Les psychanalystes apprécieront. Romain Gary, sans surprise, les méprisait profondément.
À l’image de son créateur, le personnage garyen est un personnage excessif, et les histoires dont il est le héros (ou l’anti-héros) n’ont rien à envier aux mythes d’antan : « Figure récurrente dans l’œuvre de Gary, le mythe se définit comme une fiction qui permet à la fois de résister et de rêver, ou plutôt de faire du rêve un instrument de résistance. Face aux désillusions, aux contraintes ou aux oppressions de toutes sortes, il oppose la primauté du spirituel, réaffirme une foi dans l’imaginaire et contribue ainsi à la persistance de l’espoir. »[9]
Cet amour du mythe n’est sans doute pas étranger à la fabrication de sa propre légende. Force de styles et de noms de plumes multiples (celui d’Émile Ajar lui vaudra en 1975 son second prix Goncourt pour « La Vie devant soi »), l’auteur prend un plaisir fou à brouiller les pistes, quitte à mentir beaucoup. Il estime d’ailleurs que « être toujours sincère et dire toujours la vérité, c’est une forme extraordinaire (…) de muflerie, d’égoïsme et d’indifférence aux autres » avant de poursuivre : « on m’a fabriqué un personnage de Romain Gary qui me tient prisonnier et m’est totalement étranger. »[10]
La confusion psychique totale témoigne d’un jugement parfaitement juste
Malgré son aspect confus, le récit en spirale de « Gros-Câlin » est un succès critique et commercial, et le mystérieux Émile Ajar se fait une place au soleil alors que Romain Gary semble être en déclin. Caché derrière son pseudonyme, l’écrivain pousse à son paroxysme ce que Roland Barthes appelait la mort de l’auteur. Dans son essai du même nom, le sémiologue affirme que « l’écriture est destruction de toute voix, de toute origine. (…) dès qu’un fait est raconté, à des fins intransitives, et non plus pour agir directement sur le réel, (…) la voix perd son origine, l’auteur entre dans sa propre mort. » Ainsi, poursuit-il, « c’est le langage qui parle, ce n’est pas l’auteur »[11]. Plus tard, dans son essai « La chambre claire », il écrira : « L’impuissance à nommer est un bon symptôme de trouble. »[12], une phrase qui fait curieusement écho aux considérations de Michel Cousin, persuadé que « [l]a confusion psychique totale témoigne d’un jugement parfaitement juste »[13].
En dépit de l’humour dévastateur du texte, l’angoisse et le délire sont omniprésents, et les idées suicidaires abondamment exprimées dans une langue explosive teintée de bourdes verbales et de calembours. À la lumière des événements qui marqueront par après la vie de Romain Gary, ce texte de 1974 peut sembler étrangement visionnaire : le 30 août 1979, la mère de son fils, l’actrice Jean Seberg, met fin à ses jours à la suite d’une longue période de dépression. L’écrivain la suivra dix-huit mois plus tard, le 2 décembre 1980.
Dans sa note rédigée à l’intention de la presse, il s’explique :
« Pour la presse. Jour J. Aucun rapport avec Jean Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s’adresser ailleurs.
On peut mettre cela évidemment sur le compte d’une dépression nerveuse. Mais alors il faut admettre que celle-ci dure depuis que j’ai l’âge d’homme et m’aura permis de mener à bien mon œuvre littéraire.
Alors, pourquoi ? Peut-être faut-il chercher la réponse dans le titre de mon ouvrage autobiographique, « La nuit sera calme », et dans les derniers mots de mon dernier roman : « Car on ne saurait mieux dire ».
Je me suis enfin exprimé entièrement. »
« Le suicide d’Ajar n’est pas un geste désespéré. Il n’est pas non plus un aveu d’impuissance. En se donnant la mort, Gary-Ajar se fait une légende (…) Choisir sa mort, c’est choisir le dernier acte. Gary-Ajar reste l’une des grandes énigmes de la littérature française. »[14]
Son dernier ouvrage, « Vie et mort d’Émile Ajar », envoyé à son éditeur le jour de sa mort, s’achève sur les mots suivants : « Je me suis bien amusé. Au revoir et merci. »
Comme si toute sa vie n’avait été qu’une vaste plaisanterie…
Références
[1] Tous les intertitres sont tirés du roman « Gros-Câlin ».
[2] In « Gros-Câlin », Romain Gary (Émile Ajar). Mercure de France, 1974 ; Folio, 2012.
[3] Raymonde Guérin, « Le mythe de Protée dans l’oeuvre d’Émile Ajar : essai de lecture psychocritique ». Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi, 1994. https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5121/
[4] In « Gros-Câlin », Romain Gary (Émile Ajar). Mercure de France, 1974 ; Folio, 2012.
[5] Robert Bellerose, « Jeux de surface dans Gros-Câlin ». Thèse (M.A.), Université du Québec à Trois-Rivières, 1986. https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5793/
[6] Radioscopie, France Inter, 26 octobre 1978. https://www.franceinter.fr/emissions/radioscopie-les-grands-artistes-du-xxe-siecle/les-grands-artistes-du-xxie-siecle-romain-gary
[7] Céline Ther, « La Magie dans l’œuvre romanesque de Romain Gary et Émile Ajar ». Thèse, Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, 2009. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00739521
[8] In « Pseudo », Romain Gary (Émile Ajar). Mercure de France, 1976 ; Folio, 2004.
[9] Nicolas Gelas, in « La France des écrivains. Éclats d’un mythe (1945-2005) », Marie-Odile André, Marc Dambre, Michel P. Schmitt (éds.), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011.
[10] Radioscopie, France Inter, 26 octobre 1978.
[11] Roland Barthes, « La mort de l’auteur ». Mantéia, 1968.
[12] Roland Barthes, « La chambre claire : note sur la photographie ». Gallimard, 1980.
[13] In « Gros-Câlin », Romain Gary (Émile Ajar). Mercure de France, 1974 ; Folio, 2012.
[14] Céline Ther, « La Magie dans l’œuvre romanesque de Romain Gary et Émile Ajar ».